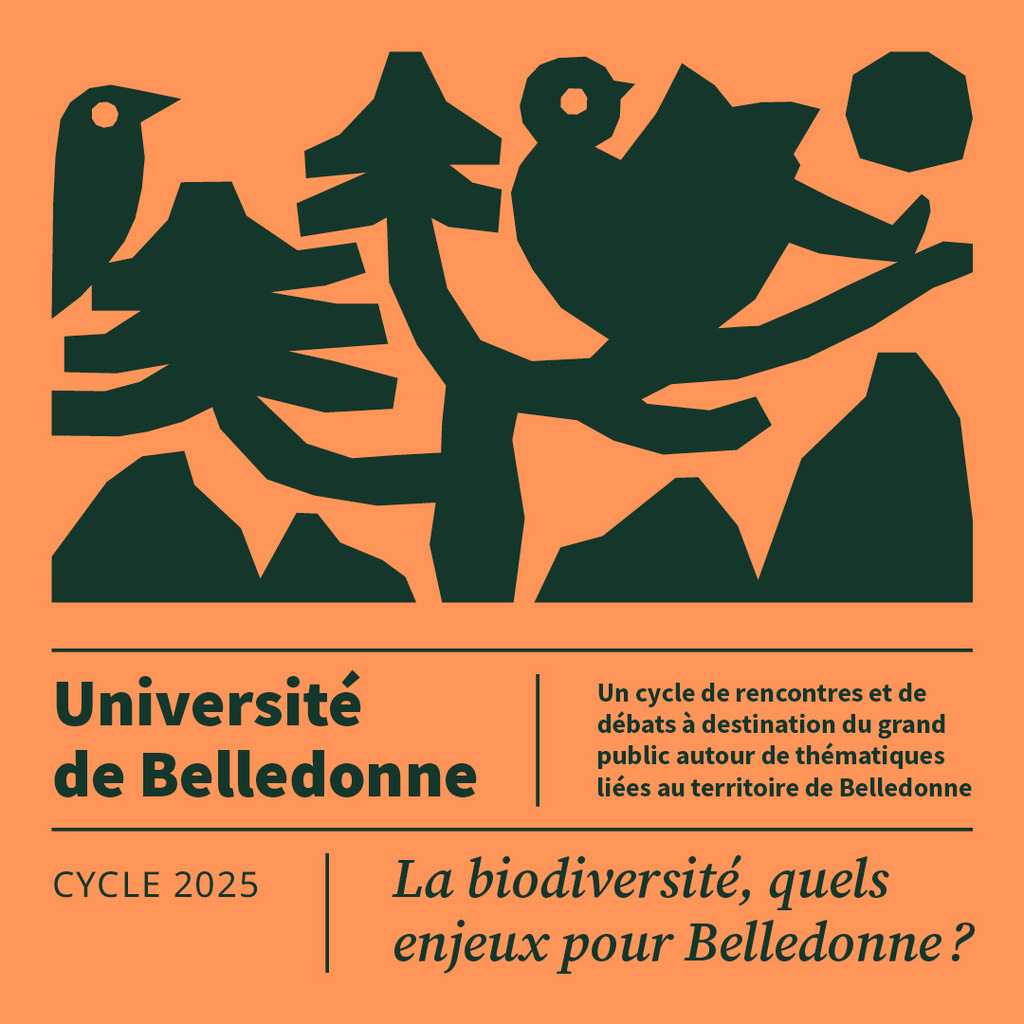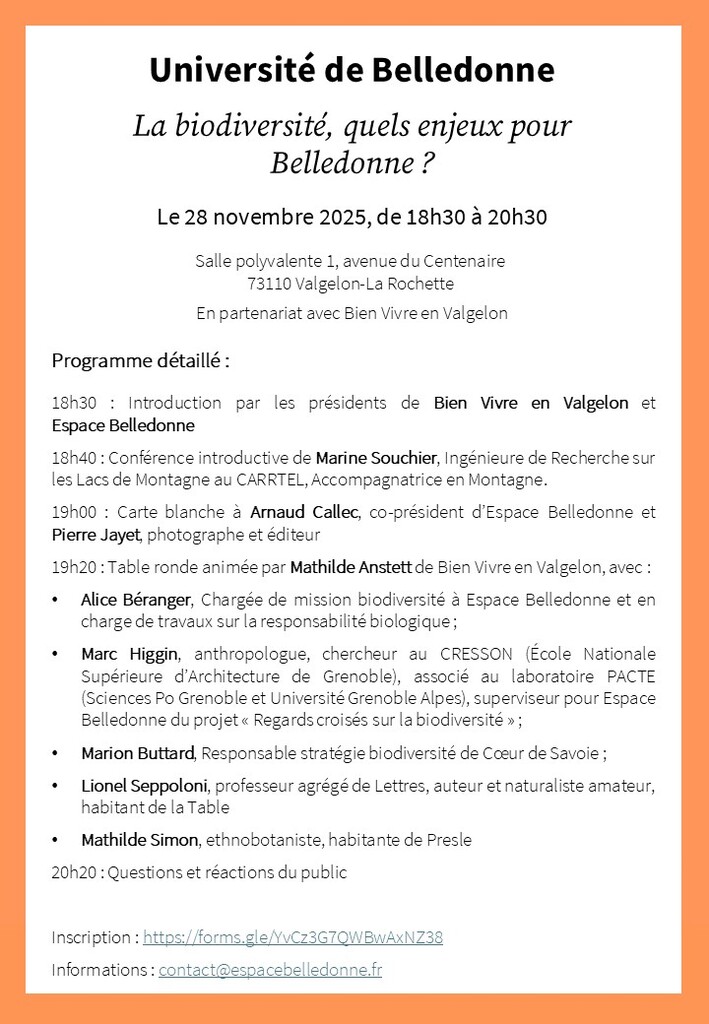Dépersonnalisation temporaire

Revenu physiquement mais pas encore tout à fait mentalement de l’une de ces escapades ferroviaires et musicales que j’affectionne du côté de mes vies secrètes (vies rêvées plutôt que réellement vécues, vies parisiennes et parallèles où flamboient dans la nuit de grandes lettres rouges au pied desquelles se pressent des foules extatiques), je reçois avec stupeur une image me montrant ma propre carte bleue ainsi que diverses autres affaires manifestement perdues hier sur le chemin de La Martinette et qu’une aimable inconnue se propose de glisser dans ma boîte aux lettres à la fin de sa propre promenade (Marine, si d’aventure vous tombez sur ces lignes, je me permets de publiquement vous remercier pour votre gentillesse !). Je ne m’étais pas aperçu de cette perte. Je ne peux m’empêcher de songer que ce n’est pas seulement mes cartes que je suis enclin à perdre, mais mon identité.
De fait, comme un acteur qui rentre de tournée, j’ai bien du mal à reprendre mon rôle, mes rôles ordinaires de promeneur de chien, de professeur, de père ou d’écrivain semi-troglodyte, ou plus exactement il m’est difficile de ne pas considérer ce que je suis et ce que je fais comme autre chose qu’une possibilité d’existence parmi d’autres. Il m’arrive de ressentir, comme tout un chacun peut-être (mais je n’en sais rien), des accès de dépersonnalisation plus ou moins poussés. Pourquoi suis-je dans ce corps humain et pas dans un autre ? Pourquoi est-ce que je vis cette vie et pas une autre ? Ce sont de telles sensations qui peuvent vous conduire à bifurquer, à changer d’aiguillages, à disparaître, comme tous ces personnages des romans de Paul Auster qui, après une série de catastrophes telles que la mort de toute la famille, prennent la tangente, ne rentrent pas chez eux, s’inventent un nouveau nom…
Je sais que c’est un leurre. La vie que j’ai construite ici, le métier que j’exerce, mes routines, mon lieu, tout cela en grande partie me constitue, et si j’ai pu croire à une certaine période qu’une métamorphose radicale allant jusqu’à un changement d’identité restait possible, je n’y crois plus maintenant. Celui que je suis, aussi étrange et précaire puisse-t-il parfois m’apparaître, existe bel et bien, non comme un masque ou une convention mais comme une indéniable quoique relative réalité. Les personnages de Paul Auster ne sont précisément que des personnages, des doubles fictifs qui se ressemblent tous et que le romancier s’ingénie à démultiplier jusqu’au vertige dans les miroirs de ses mises en abyme.
Sans doute suis-je particulièrement sensible à ces échappées de l’imagination depuis que je me suis mis en tête d’écrire Le Livre de Madère en en faisant un roman (rebaptisé depuis, avec l’autorisation de Dominique A, Le Livre d’Éleor). Une certaine poésie (que je peux par ailleurs pratiquer) me semble trop monocorde, trop confortable, qui aménage la réalité quotidienne que le roman tend facilement à supplanter ou que certaines entreprises littéraires peuvent fissurer ou détruire. Bien sûr il y a en moi un poète bucolique qui savoure le calme parfois tumultueux du torrent, la présence rassurante du chien à ses côtés, mais il y a aussi un chanteur pop à la voix de haute-contre façon Klaus Nomi (ou bien Nina Hagen, que j’écoute en rédigeant ces lignes), un voyageur parfois intrépide, un naturaliste, un moine, un arpenteur des villes, etc. À défaut de me créer comme Pessoa toute une galerie d’hétéronymes (je n’en ai ni la force, ni l’envergure), l’adoption d’une forme romanesque incluant l’observation poétique m’apparaît comme une bonne façon de lutter contre la tentation de me perdre dans des dédales imaginaires dont je sais par ailleurs qu’ils ne me réussissent pas tellement, tout en intégrant et en exploitant comme il convient cette tentation en laquelle gisent des trésors – car les textes sont plus riches quand ils sont nourris de contradictions, tout comme les parfums quand ils sont composés d’éléments hétéroclites (nonobstant ce parfumeur japonais dont on parlait hier et qui n’élabore ses fragrances qu’à partir d’une unique molécule dans une logique de simplification très japonaise), tout comme aussi ces musiques dans lesquelles se mêlent harmonies et dissonances. Je sais qu’il y a certains artistes qui, par goût « japonais » de la simplification ou par idéologie, ont souhaité et peut-être réussi à n’être qu’une seule chose, limitant volontairement ou pas leur palette, épurant leurs voix. Zola voulait n’être qu’un romancier naturaliste obéissant à une logique quasi scientifique — mais le meilleur souvenir que je garde de ses romans lus il y a si longtemps est celui des descriptions romantiques en diable du Paradou dans La faute de l’abbé Mouret…
Ainsi l’écriture accompagne-t-elle en les encadrant ces brefs moments de dépersonnalisation partielle.
15/05/23