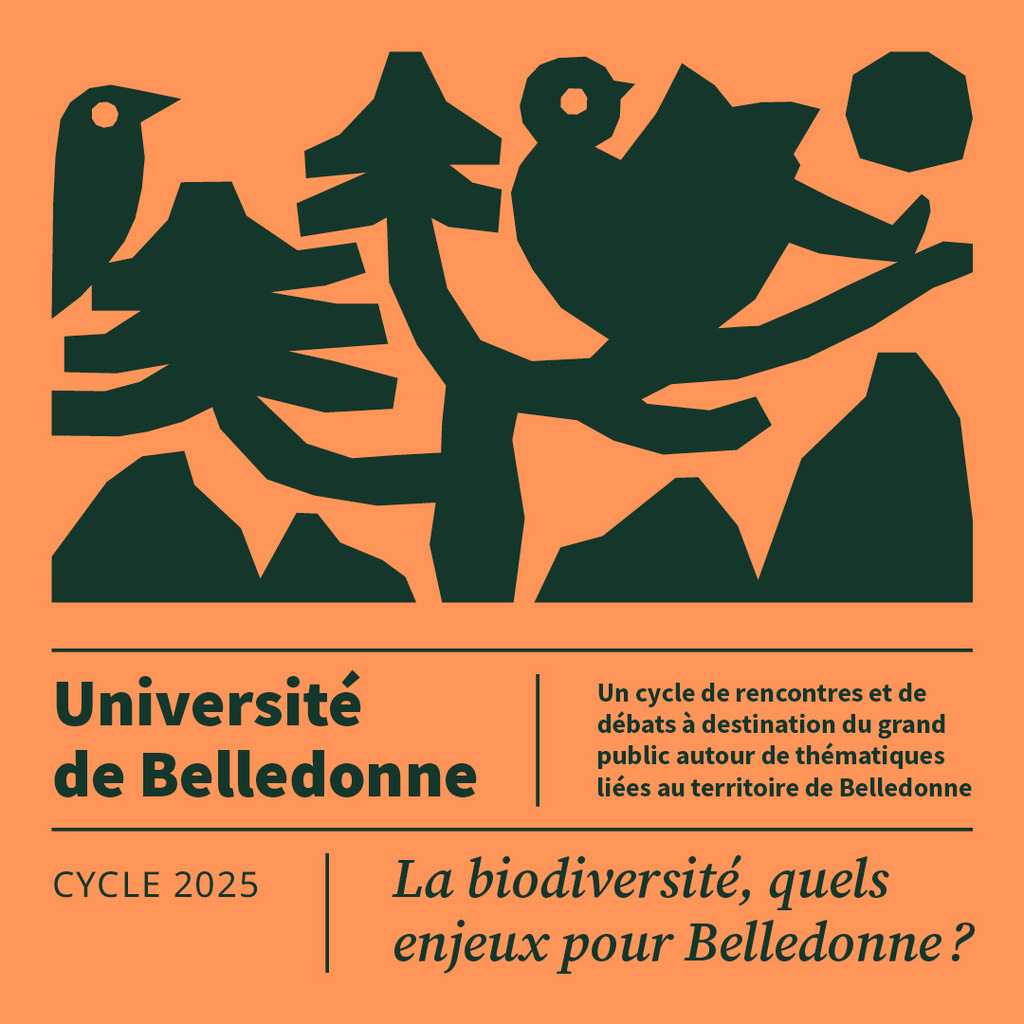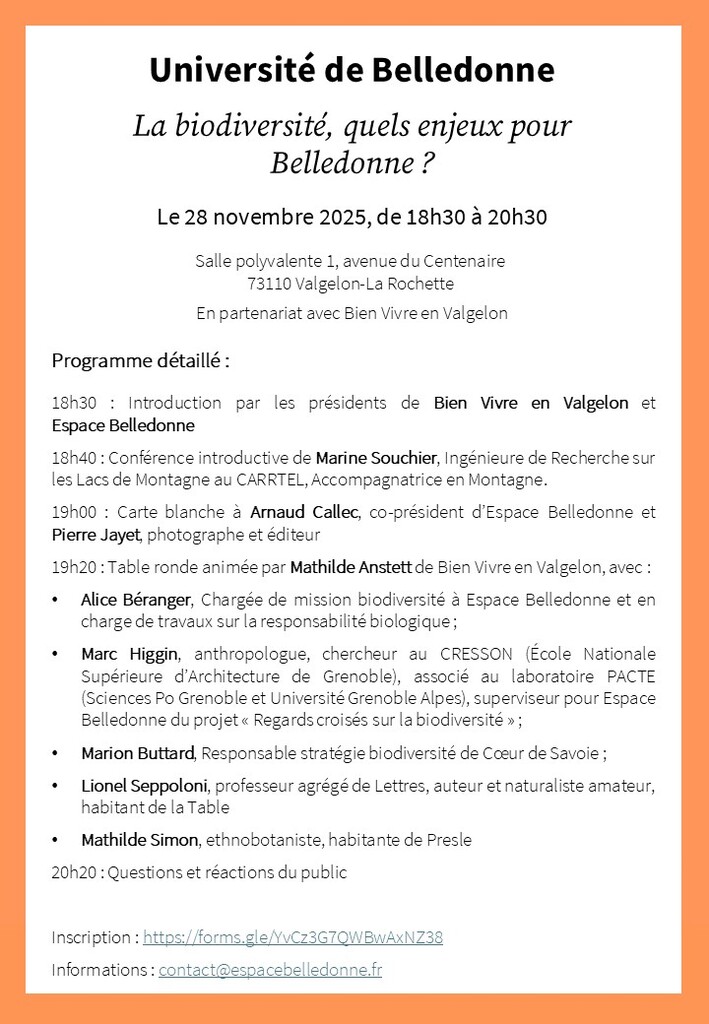Les invasives (2)

À la faveur d’un de ces moments où la température extérieure, le taux d’hygrométrie, la lumière et mes propres conditions physiques et mentales s’équilibrent, je m’installe sur une chaise dans le jardin pour continuer la lecture du livre de Céline Curiol Invasives, pendant que les chiens et les chats se courent après, montant et descendant la pente en slalomant, grognant et feulant. Un pouillot véloce fourrage dans le saule marsault au-dessus de ma tête, dont le chant n’interrompt pas mais accompagne et enrichit ma lecture. Un pic épeiche tambourine, un pivert laisse éclater son rire et une pie se livre à de bruyants claquements de bec… J’aime lire et écrire dans ma chambre-chalet désormais si parfaitement isolée que la température reste plus élevée de deux degrés par rapport au reste de la maison quand il fait froid dehors, mais le faire ainsi au jardin permet de rester en contact sonore continu avec ces habitants du dehors auquel le double-vitrage impose le silence, quand je suis dans ma chambre, si bien qu’il me faut lever les yeux du livre et regarder le poirier pour à nouveau les percevoir.
Je lis, donc, ce récit de l’immersion d’une écrivaine dans la réserve du Vigueirat, en Camargue, en ce milieu censé être naturel mais qui est en fait, on le sait bien, un chef-d’œuvre d’artifice. Je peine d’abord à m’identifier, car l’autrice, sensible au manque de confort de la cabane et manifestement très urbaine, exprime sa peur des souris, ce qui m’étonne un peu ; un certain manque de rigueur dans les connaissances naturalistes et la définition même d’espèce invasive fausse par ailleurs la réflexion, mais l’expérience individuelle aboutit tout de même peu à peu à un questionnement stimulant non seulement sur le sens à donner à cette notion de réserve et de préservation figée d’une nature vouée au mouvement, mais sur notre rapport aux espèces dites invasives et, partant à notre propre rapport au monde.
D’après l’autrice, toute espèce, qu’elle soit exotique ou autochtone, est susceptible de devenir invasive, dès lors qu’elle n’entretient plus avec son habitat de relations riches, complexes, vivantes et équilibrées. Ce serait manifestement à nuancer, si l’on se réfère à la définition précise que donne le site du Muséum d’histoire naturelle du terme d’invasive :
Les biologistes ont défini les espèces exotiques envahissantes ou espèces invasives comme des espèces vivantes qui, déplacées de leur milieu d’origine vers un endroit nouveau pour elles, y trouvent des conditions idéales pour proliférer, aux dépens des espèces locales et éventuellement des activités humaines. Cela concerne aussi bien les végétaux que les animaux, des mammifères aux insectes, en passant par les oiseaux, les mollusques, les vers, etc. Pour devenir invasive, l’espèce exogène doit passer plusieurs étapes. La première, c’est le voyage.
De ce point de vue, on peut sans doute considérer l’homme, ce voyageur invétéré, comme une super espèce invasive… Avec le temps, il est cependant possible que l’espèce invasive parvienne à établir des interactions avec le milieu, à trouver sa place, sa niche écologique, ce qui fera d’elle une nouvelle autochtone (en espérant quand même qu’elle n’ait pas tout détruit avant…). On comprend l’effroi des gardes de la réserve, dont le milieu a été fragilisé depuis le XIXe siècle par les activités humaines, lorsque la jussie sud-américaine menace de tout étouffer ou lorsque l’ibis sacré pointe son bec parmi les ibis falcinelles ; pourtant, lorsque le garde revient à regret pour détruire les œufs de l’ibis en question, il constate avec soulagement qu’un grand-duc s’est déjà chargé de la besogne…
Je ne sais pas s’il faut laisser faire, tant les interventions humaines sont partout omniprésentes, mais, lisant Invasives, je songe surtout à mes impatientes de l’Himalaya. Lorsque j’ai commencé à voir l’ampleur de l’invasion, j’ai décidé qu’à chacun de mes passages j’en arracherai quelques plants, estimant qu’à force cela contribuerait à limiter les dégâts. J’ai très rapidement arrêté, non par découragement devant l’inutilité du geste mais à cause de sa laideur. Je déteste ce geste d’arracher, que ce soit des impatientes le long du torrent ou les terribles cognassiers du Japon que nous avions imprudemment plantés il y a dix-sept ans dans mon jardin (afin d’établir un lien avec celui de mes parents où l’on avait pris les rejets), et que je suis cependant en train d’éradiquer avec l’aide Élodie (dont le terrain est envahi en même temps que le mien). Lorsque je tirais sur les hautes tiges des impatientes, pour le coup impuissantes à se défendre et qui, contrairement aux cognassiers, n’offraient aucune résistance, j’avais le sentiment d’accomplir une action ignoble — comme l’éleveur d’abeilles tuant d’un coup de talon la reine vieillissante qu’il souhaite remplacer, comme tous les hommes qui détruisent « pour de bonnes raisons ». J’ai entendu la réflexion d’une de ces hautaines demoiselles parfumées, tout de rose fleurie, confiant à sa voisine en blanc : « À ce compte-là, il faudrait qu’il songe à s’éradiquer lui-même, cet humain. »
Depuis, je les observe sans vergogne, « mes » impatientes. Leur croissance prodigieuse et leur déchéance spectaculaire rythment les saisons de mes promenades. Leur vigueur dans tous les domaines, l’olfactif surtout, me fascine. Et puis, je me suis mis à guetter aussi les interactions qui indubitablement se sont mises en place avec les bourdons, les pucerons et les différents insectes qui viennent s’y nourrir, ainsi qu’avec leurs voisines les ronces auxquelles elles concèdent, pour des raisons que je ne comprends pas, certaines parcelles qu’elles pourraient aussi bien occuper.
Voilà ce que j’ai fini par me dire. Ces impatientes sont notre œuvre, disséminées de notre fait. Si, au fil des ans, au lieu de tout coloniser en appauvrissant la biodiversité déjà bien entamée de cette pauvre forêt secondaire où serpente un torrent déserté par les écrevisses depuis des décennies et exploité pour l’électricité, elles parviennent à trouver leur place, je le pourrai aussi, nous le pourrons nous tous, humains pas si stupides que ça, après tout, capables d’adaptation, et capables peut-être d’établir avec tous les êtres qui peuplent notre monde commun une certaine connivence. Peut-être.
On a besoin de traducteurs, d’intercesseur en lesquels on puisse se reconnaître un peu, pour établir ces liens : ainsi donc des plantes que l’on accueille dans nos jardins, ainsi de nos animaux domestiques, façonnés au fil des siècles pour notre usage et convenance, ainsi aussi de tous ces sauvages qui circulent alentour, insectes en nos maisons, oiseaux sur nos balcons, chevreuils dans la forêt, jusqu’à ce que de proche en proche le monde lointain qu’on avait occulté redevienne monde visible, monde parlant, monde chantant.
19/09/24