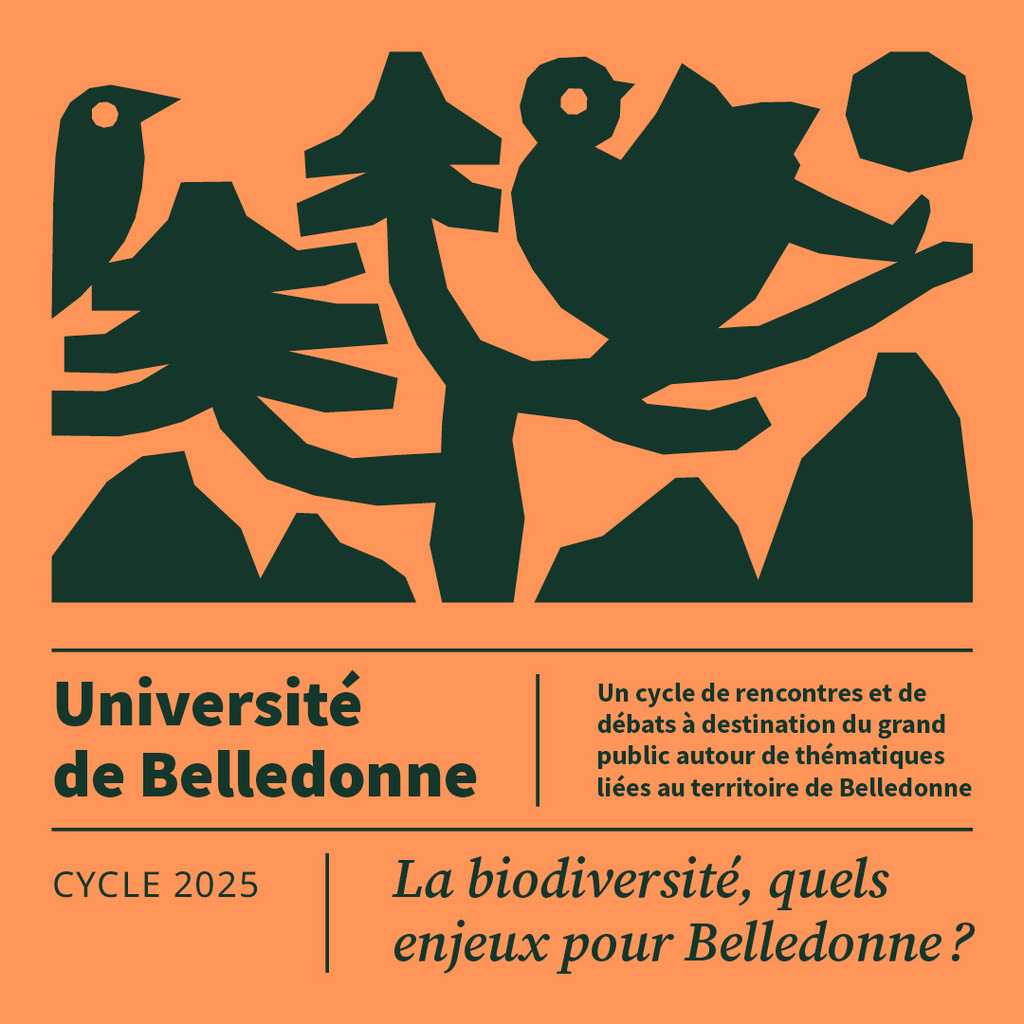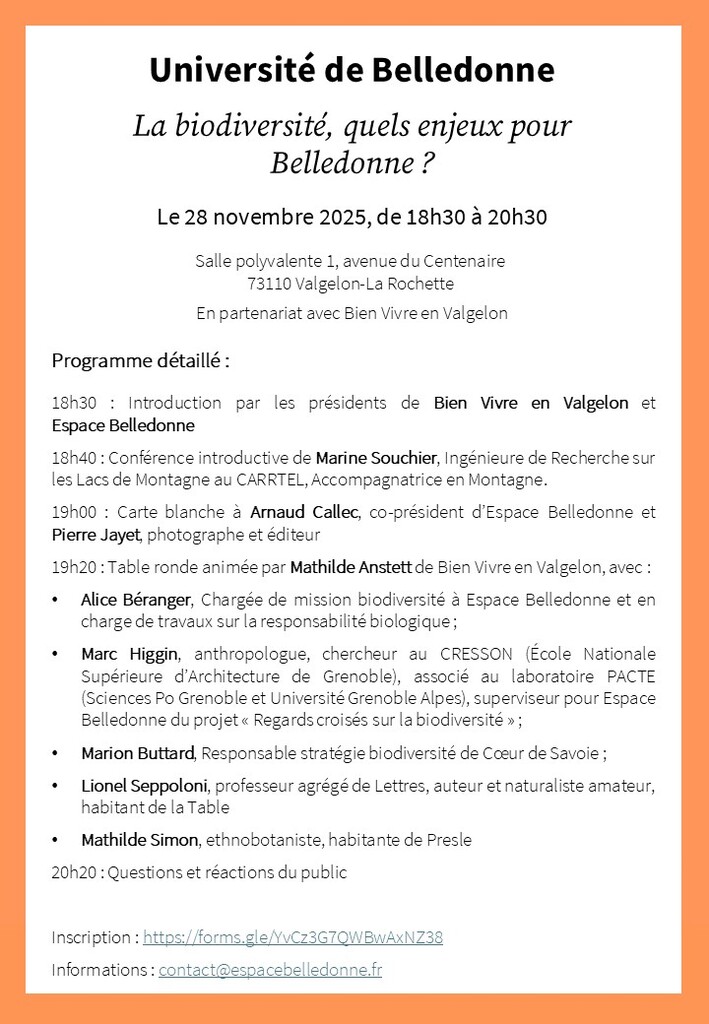Je dis : « Blaireau »…

« Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets ».
Mallarmé
Je me souviens d’un cours à l’université ou un professeur de sémiologie doctement répétait que « le mot est le meurtre de la chose ». J’étais sorti furieux : passionné d’ornithologie, je passais une bonne partie de mon temps libre à observer et à nommer des oiseaux dont le vol pour autant n’en était nullement arrêté, et je trouvais cette idée scandaleuse.
À bien y réfléchir, cette formulation lacanienne est certes une provocation, mais elle n’est pas tout à fait fausse. Dans bien des cas, le mot peut être le meurtre de la chose. Je dis : « Blaireau ! », et l’assemblée s’esclaffe. Dans un sourire niais on me répond : « animal puant », « grossier personnage », « loin des blaireaux près des marmottes », Buffon qui n’en avait jamais vu un seul vivant ajoute même « gros paresseux ! », ou bien on me parle du cycliste Bernard Hinault dont le surnom de « blaireau » était en revanche un compliment pour sa ténacité. Mais le blaireau a disparu. On ne le voit pas, on ne peut pas le voir. À une amie intéressée par la nature, ma compagne Élodie s’empresse de montrer mes vidéos de blaireaux, convaincue d’avance de voir son visage s’illuminer. Des blaireaux ? Elle jette à peine un regard poli, avant de passer à autre chose. Ce n’est même pas qu’elle ne regarde pas, c’est qu’elle ne peut pas le voir, le blaireau. Ce mot n’éveille rien de vif dans son esprit, pas de souvenirs, rien que de vagues clichés qui occultent la réalité.
Le mot n’est peut-être pas le meurtre de la chose, mais il peut y aboutir. Au nom de ces clichés, on tolère le déterrage, on justifie l’injustifiable. Ce ne sont que des blaireaux. Les mots deviennent crosse ou botte dans la tête, dents des chiens, fusil.
Quand le naturaliste pourtant dit : Meles meles, je dis, moi, que la bête pointe son museau. Meles meles, ça y est, les pages d’un livre d’histoire naturelle se tournent. Et puis, si l’on dit « Blaireau d’Eurasie » plutôt que « d’Europe », ça y est, la nature extrême-orientale de notre mustélidé transparaît, avec ce petit air asiatique, exotique, ce masque chinois dirait-on comme le masque de la mésange bleue trahit ses origines orientales aussi, et l’on voyage, on ouvre un horizon.
Les mots peuvent être fusil (n’oublions jamais qu’il fut le premier instrument du naturaliste) mais aussi loupe, jumelles, suivant l’usage qu’on en fait. Pour le naturaliste ils facilitent ce regard attentif, décentré de l’humain, recentré sur l’alien qu’il étudie, certes, mais qu’il aime aussi de mieux en mieux à force de le connaître.
Et puis les mots peuvent être caméra : outils pour capter et transmettre un réel qu’on s’est approprié. Je dis, moi, « blaireau », et je convoque aussitôt, grâce aux expériences accumulées, une multitude d’images précises. Si je dis « Vara », c’est encore mieux : je la vois, ma belle blairelle aux reflets chamoisés, aplatie façon marmotte sur l’esplanade du haut au soleil d’un après-midi de mai. Je la vois se presser pour la première fois à l’extérieur du terrier contre ses blaireautins. C’est je dis « Cheg », je revois mon gros mâle sombre (il me manque, qu’est-il devenu ?), un peu dépenaillé, une plaque de poils sur le côté droit du museau est partie, allongé sur le dos en train de se gratter, ou bien tout terreux et penaud devant la porte du terrier refermé par Vara après un accouplement maladroit. Si je dis « Courage », « Prudence », je fais vibrer toutes les harmoniques d’une expérience intime dont je transmets, je l’espère, des échos dans ces lignes.
Vous qui avez eu la patience de me lire jusqu’ici, lorsque vous entendrez le mot « blaireau », ce mot en aucun cas ne pourra être « le meurtre de la chose ». Il n’y aura plus ni meurtre, ni chose, mais la vie foisonnante d’une boule de poils familière, amicale, la vie vivante, la belle connivence qui rend le monde et tous ses habitants non-humains si aimables.
14/06/25