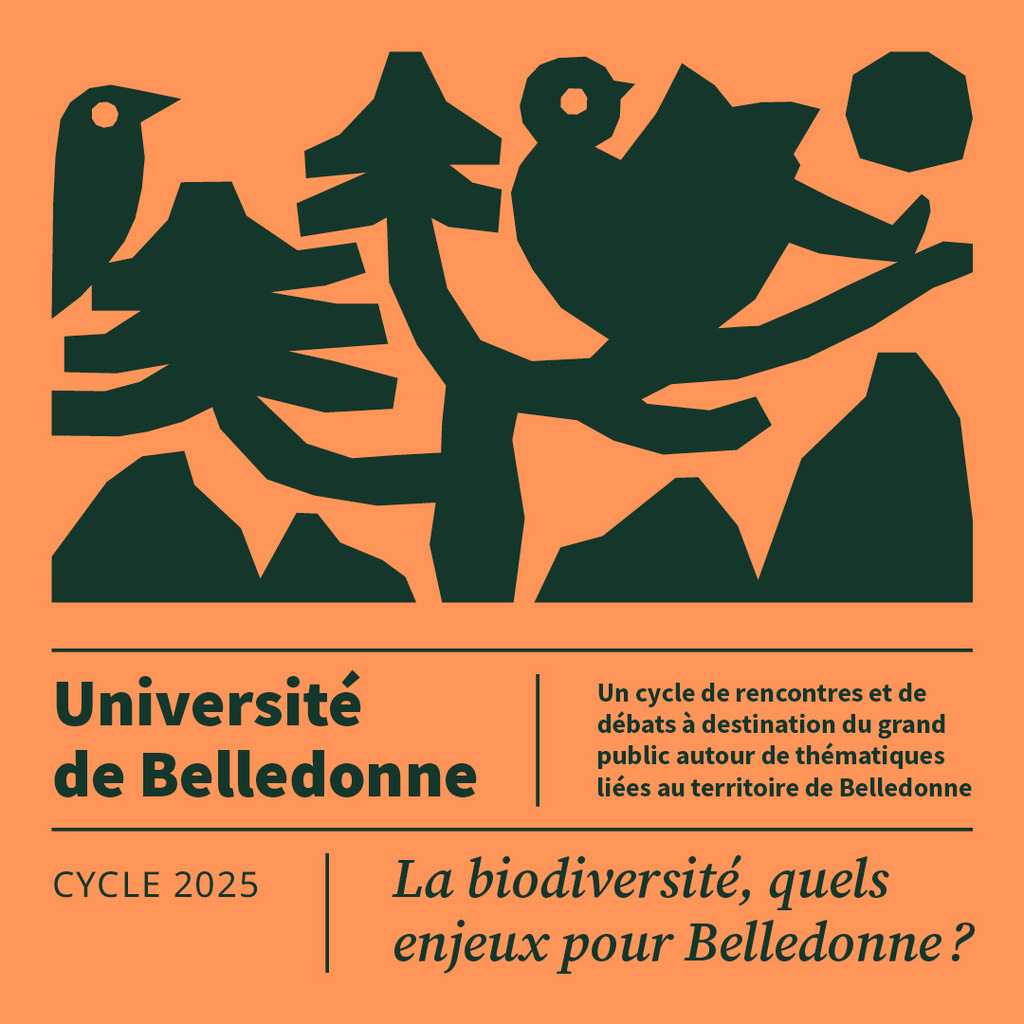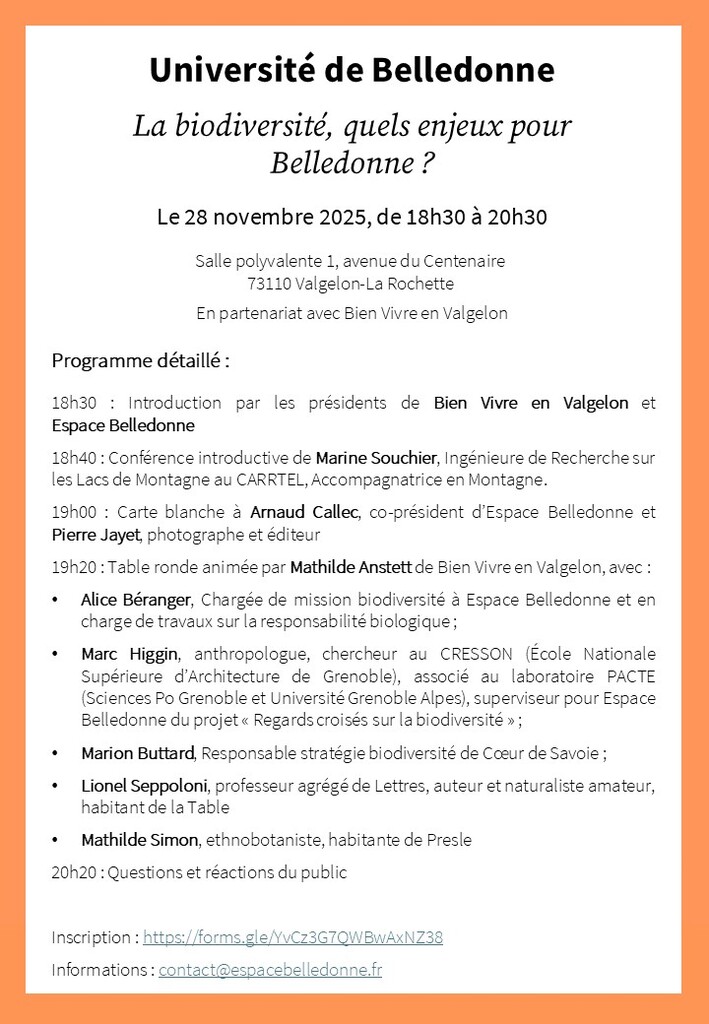Ceux que la nuit nous cachait
défense & illustration de la Méliphilie
Depuis 2019, je suis le quotidien de cette famille. J’ai cherché longtemps leur blaireautière, car elle m’intriguait grandement. Depuis que je l’ai trouvée, je suis leur vie à travers mes caméras. (…) Avec les années, un attachement et un amour se sont créés. »
Gil Gautier, photographe, France 3, 29/04/25
Phil Drabble emphatically declared that he suffered from ‘a cute and incurable melophilia, a rare and delightful ailment… The only symptom is a deep affection for badgers.’ While Drabble intended this term to be a reference to Meles meles, it is an unfortunate neologism, for not only did he not coin melophilia, the word actually refers to a love of music (…). Dr John Aveline, a professional Latinist, suggested ‘meliphilia’ (…) as the more appropriate Latin forms of Drabble’s ailment.
Daniel Heath Justice, Badger
Même en leur absence, même arpentant à plus de trois mille mètres un territoire de pierre, de rares névés et de torrents taris où aucun blaireau ne saurait se risquer, je pense à eux. Je les vois partout, dans le délire rayé des rêves qu’attise le manque d’oxygène, dans la fuite de l’hermine surprise sur le sentier, dans les gueules des marmottes et les ombres projetées sur les falaises au crépuscule. Le crépuscule, c’est leur heure, me dis-je. Que deviennent-ils ? Comment endurent-ils cette sécheresse qui dure, immobilisant chamois et bouquetins autour des rares points d’eau, et faisant taire l’été ?
Toutes les conversations curieusement me ramènent au blaireau, je n’aurais jamais pensé que les gens fussent à ce point obsédés par mon mustélidé ! Lorsqu’au collège je commence avec mes Quatrièmes la séquence de français intitulée : « Dire l’amour », j’aime poser une série de questions qui lancent le débat, et notamment celle-ci : « l’amour peut-il rester tu ? » (oui, « tu », mais pas toi, c’est le participe passé du verbe « taire »). On aboutit en général à cette évidence que connaissent tous ceux qui ont le malheur d’avoir dans leur entourage un ami amoureux qui ne cesse de radoter à propos de l’objet de sa passion. L’amour doit être dit, sous peine de s’étioler et de mourir, ou bien sous peine de soi-même exploser ! Il mobilise l’être tout entier, et en l’absence de l’être aimé, la parole offre un exutoire et même une possibilité d’expansion, le discours amoureux permettant de donner aux rêveries une incarnation qui lui donne consistance et le prolonge.
On jugera peut-être curieux de parler d’amour à propos de blaireaux, mais c’est pourtant le terme qui spontanément vient à quiconque côtoie longtemps un animal, qu’il soit domestique ou sauvage : cherchant sur Internet des témoignages, je trouve celui du photographe Gil Gautier qui constate qu’après avoir suivi une famille de blaireaux pendant plusieurs années (l’heureux homme !), « un attachement et un amour se sont créés. » C’est dit.
« Amour » sonne cependant à mes oreilles de façon un peu trop sentimentale et ambiguë. Plutôt que d’amour-des-blaireaux, « love badger » ou « blaireauphilie », comme je l’avais un temps envisagé, j’ai finalement choisi de mettre en avant, avec l’aval du professeur de latin évoqué par Daniel Heath Justice, le néologisme de « méliphilie », qui allie dans un savant et joyeux méli-mélo la mélilogie du naturaliste, la mélimanie de l’autiste et la mélipoétique du poète !
Le poète (autiste ou non) et beaucoup de personnes autistes (qu’elles écrivent des vers ou pas), ont précisément une capacité particulière à entretenir avec le monde, ou certains objets du monde sur lesquels se focalisent leur intérêt, une relation dont l’intensité est telle qu’on peut la qualifier d’amoureuse. Ils entretiennent avec l’arbre ou l’animal rencontré une proximité qui peut aller (au moins métaphoriquement) jusqu’à la fusion amoureuse. « Si tu veux connaître le pin, deviens le pin », disait Bashô, et c’est aussi ce après quoi court comiquement et tragiquement Charles Foster quand il tente de se mettre « dans la peau d’une bête ».
J’assume donc sans vergogne, et j’explore, ma passion méliphile. Mais une autre obsession est venue rejoindre la première, et plus encore depuis que Vara et les blaireautins ont changé de terrier : écrire un livre pour les célébrer, les honorer, les prolonger et faire savoir au monde entier à quel point ils sont aimables, et que leur commerce guérit.
Ah, en voilà une idée : le commerce des blaireaux guérit ! Lors de retrouvailles juste avant mon départ pour les Écrins, et comme j’avais longuement parlé des blaireaux, Valérie m’a suggéré d’en faire un livre que je pourrais proposer à un éditeur bien connu. Elle m’a cependant lancé aussitôt un défi : pour convaincre, il faut faire un pitch, c’est-à-dire une phrase qui résumerait le projet de façon accrocheuse, pour susciter l’envie, même si cela ne correspond qu’à un aspect du travail. « Le pitch doit être une accroche courte et efficace du projet, afin d’inciter le producteur à proposer un rendez-vous à l’auteur ou à signer rapidement une option afin de bloquer les droits du projet », précise (un peu lourdement) Wikipédia…
C’est là une démarche journalistique, voire publicitaire, prodigieusement difficile pour un bavard mélicentré (il m’est par ailleurs difficile de me mettre à la place d’autrui et je n’ai jamais écrit pour être lu ni publié mais seulement par nécessité personnelle). Cette idée du pitch à trouver m’a accompagné tout au long de mes randonnées alpines, avec parfois un sentiment d’impuissance qui a pu ponctuellement voiler le paysage, mais l’idée m’est venue au bout d’une bonne montée de 1500 mètres, à l’arrivée au refuge Adèle Blanchard : la rencontre avec le blaireau-guérisseur ! Ce qui donnerait (le pitch est en gras, la suite développe un peu) :
Par un sombre soir de novembre dans une pessière en Savoie, un promeneur tombe sur un terrier occupé par Meles meles, une famille de Blaireaux d’Europe, et contracte une méliphilie fulgurante. Bientôt les caméras et les affûts lui révèlent ceux que la nuit nous cachait. Il s’immisce dans l’intimité des habitants du lieu, s’émerveille de la naissance des blaireautins, devient mélilogue, mélimane, méli-man, fou de blaireaux, addict aux rayures bicolores, accro aux crépuscules ; puis vient l’été, la famille disparaît, et il lui faut aller creuser plus loin à la recherche des blaireaux perdus…
Sous-section de la biophilie chère au biologiste Edward O. Wilson, la méliphilie, quoique contagieuse, n’est pas une maladie, mais un remède salutaire contre l’indifférence à la nature et le repli sur soi. Pratiquée depuis des décennies par un trop petit nombre d’initiés, elle est désormais à la portée de tous sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Elle redéfinit notre rapport aux forêts et aux talus, aux chemins et aux routes, au visible et au caché, aux lombrics et au temps qu’il fait. Elle nous pousse à quitter nos terriers.
Au fil des saisons et des pages d’un journal méliphile où se mêlent comptes-rendus d’observations et analyses, témoignages et tentatives de traduction de ce que pourrait être le point de vue du blaireau, Meles meles, ceux que la nuit nous cachait se propose non seulement de mettre en lumière un animal injustement méconnu, mais aussi de montrer concrètement comment la rencontre avec la faune sauvage peut revivifier notre rapport au monde.
Les chasseurs aussi confusément ressentent ce pouvoir salvateur du blaireau. Un déterreur interviewé à Limoges pendant la grande manifestation de soutien aux déterrage du 15 mai 2025 a déclaré : « Les blaireaux contribuent à mon bonheur. Il n’est pas un jour où je ne pense pas à eux. » J’aurais pu dire exactement la même chose, et il y a dans cette déclaration presque folle quelque chose qui sidère, venant de la part de quelqu’un qui prend plaisir à lâcher des chiens dans le terrier, à défoncer ces galeries qui ont demandé tant d’efforts à l’animal, avant de le saisir par des pinces parfois munies de clous, de le tuer et de jeter son cadavre. Sa passion pour le blaireau est à la blaireauphilie ce que le viol est à l’amour. C’est un désir dévoyé, centré sur lui-même au mépris de son objet, une pulsion destructrice mais qui, si elle était réorientée dans le sens de la vie, pourrait peut-être redevenir saine (il faut croire en la possibilité d’éduquer les violeurs – ce qui suppose tout de même au préalable d’interdire le viol et de poursuivre ceux qui en commettent…).
Une autre relation aux animaux en général et au blaireau en particulier est possible ! La méthode : étudier, s’informer, chercher à tout lire, tout savoir sur le blaireau (se rendre compte en passant de l’étendue de ce que l’on ne sait pas), observer intensément, passionnément, mais sans jugement ni projection, la vie ordinaire des blaireaux, que ce soit à travers les caméras qu’on a soi-même posées ou les innombrables vidéos qui circulent sur Internet (il existe désormais tout un réseau de caméras connectées qui permettent de voir certains terriers ou lieux de nourrissage – ce dernier constituant par ailleurs une dérive discutable).
Le décentrement opéré est porteur de bienfaits innombrables. La beauté de ce masque bicolore qui a déjà charmé tant de dessinateurs, de ce pelage qu’à la lumière du jour on découvre moiré de reflets fauves, est un saisissement esthétique propre à transformer en poète ou en peintre le pire des bouchers. Découvrir la complexité et l’ampleur des travaux de terrassement opérés par le blaireau, animal bâtisseur qui est aux forêts ce que le castor est aux rivières, rend admiratif et humble, deux émotions extrêmement positives. Enfin, la façon saine et souple avec laquelle le blaireau occupe son territoire (qui parfois en chevauche un autre, même dans les pays où les blaireaux sont nombreux comme en Grande-Bretagne) ainsi que l’accueil fait aux autres espèces donne une leçon d’éthique.
La poésie et la peinture permettent en théorie de changer le regard qu’on porte sur le monde, et elles y parviennent parfois, auprès de certaines personnes ; mais la méliphilie est plus concrète, plus efficace et plus accessible – après avoir vu le visage de mes collégiens découvrant mes vidéos de blaireaux, j’en suis bien convaincu. François Sarano raconte qu’il a un jour emmené son petit-fils observer un rat, dynamitant ainsi les préjugés négatifs pour cette espèce que j’ai toujours trouvée admirable, ainsi que le mauvais instinct de destruction. Pour Valérie ce fut, entre autres, l’observation des araignées (et c’est vrai qu’elles sont belles et étonnantes quand on les considère un peu attentivement, tant est grande la diversité de leurs formes, de leurs toiles et des motifs qui ornent leur abdomen – sans même parler de leurs mœurs) ; mais le blaireau, tout auréolé du mystère de la nuit, aussi mal aimé soit-il, suscitera même en France moins de résistance culturelle !…
Ainsi je rêve d’un livre qui, faisant écho au travail de longue haleine de tous les naturalistes œuvrant depuis tant d’années, changerait le monde, ou une toute petite partie du monde, non pas seulement en réhabilitant le blaireau mais en montrant au grand jour la possibilité de la rencontre – ce que la nuit de nos peurs et de notre ignorance nous cachait. Je rêve d’un livre qui donne la parole à des voix très diverses, aux chasseurs pour et contre le déterrage, à l’enfant qui aurait lu ou vécu La rencontre, à cette maire de Sologne qui a eu le culot de prendre un arrêté protégeant les blaireaux, aux militants des associations, aux naturalistes engagés dans son étude et sa protection et puis, in fine, au blaireau lui-même, dans la mesure du possible avec mes moyens humains (comme le font Raphaël Mathevet et Roméo Bondon dans Sanglier, géographie d’un animal politique, ou Baptiste Morizot avec le loup dans Manières d’être vivant).
Revient aussitôt la crainte de ne pas être légitime pour mener une telle entreprise, moi dont la renommée n’excède pas de beaucoup le territoire de mes blaireaux. Je me dis pourtant dans une bouffée d’orgueil que ces connexions mentales qu’opèrent ma formation de lettré, ma jeunesse géopoétique, mon obsession de dire et ma méliphilie, seul mon cerveau d’autiste peut les susciter, et que ce livre dont je rêve ne peut être écrit par personne d’autre.
Ainsi le blaireau paradoxalement guérit-il même du manque de confiance, semble-t-il…
21/07/25