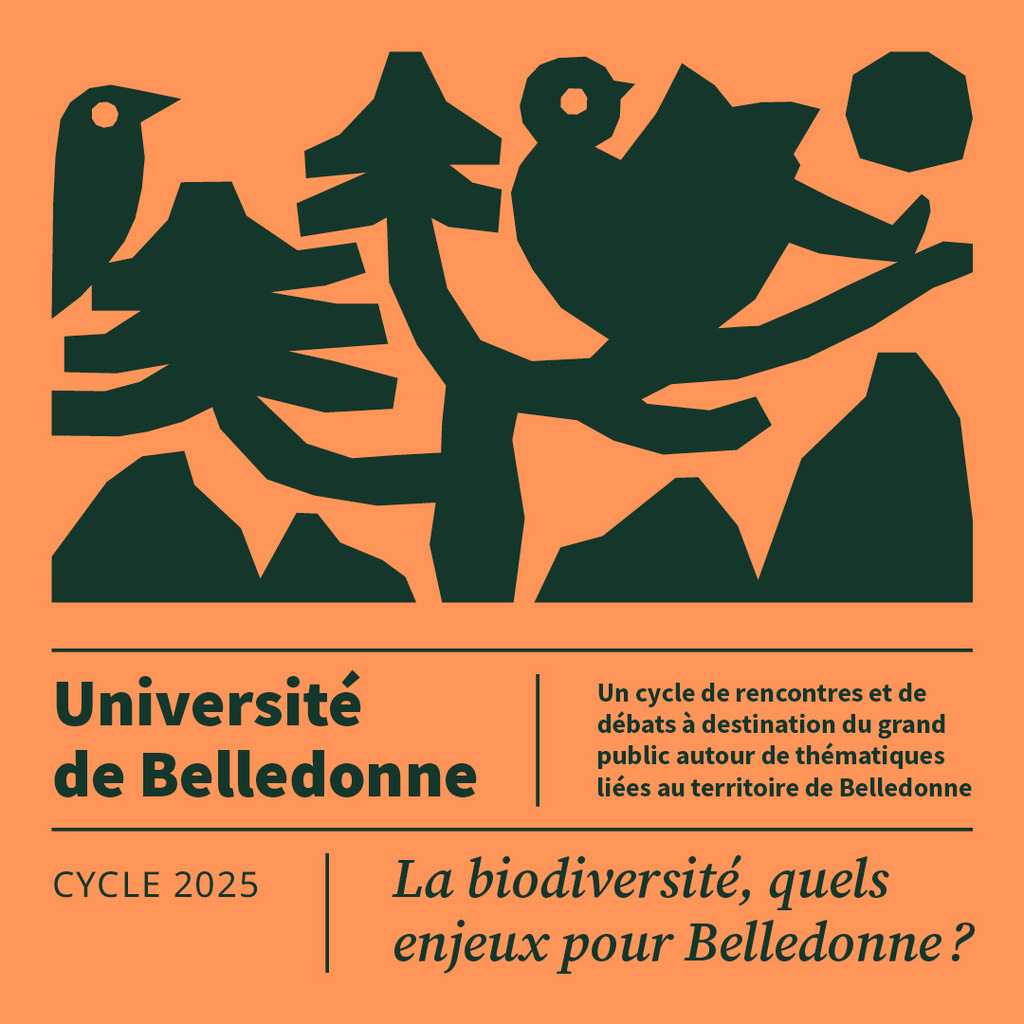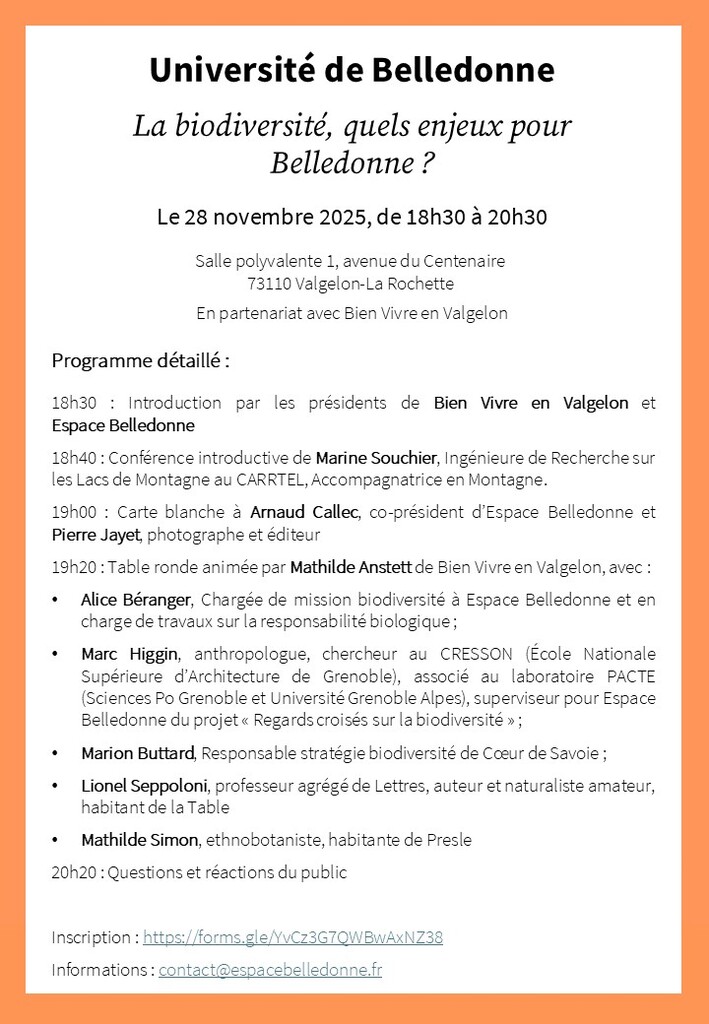Les blaireaux du Sodoma

Les fresques peintes dans certaines églises italiennes m’ont naguère fasciné presque autant que l’art des grottes, dont elles sont en un sens un lointain écho pictural. Celles qu’ont réalisé Luca Signorelli et Le Sodoma, entre 1497 et 1498, dans l’abbaye de Monte Oliveto Maggiore, commune d’Asino, province de Sienne, pour illustrer la vie de Saint Benoît, comportent dans la troisième scène un détail qui retient mon attention.
Reléguant le saint en pâmoison à gauche et semblant se moquer éperdument du miracle que trois personnages sur la droite scrutent avec perplexité (un tamis bizarrement accroché au sommet d’une colonne, on a fait plus spectaculaire…), Le Sodoma s’est représenté au centre en grand habit de cour, tourné vers le spectateur avec un sourire narquois, en compagnie de deux blaireaux. Il y a d’autres animaux alentour : deux poules qui picorent au premier plan à gauche, deux corneilles blanches naïvement dessinées dont l’une donne un coup de bec sur la queue de l’un des blaireaux, sans compter un cygne au cou déformé en arrière-plan ; mais ces blaireaux ont un statut particulier, puisqu’ils sont domestiqués.
Celui qui apparait au premier plan est bien dessiné, quoique son corps semble un peu court, avec un masque facial et une queue réalistes, de bonnes griffes, et ce petit décrochage de la truffe si caractéristique et si touchant (le taxidermiste qui a naturalisé la blairelle qui est à mes côtés au moment où j’écris l’a fort bien respecté lui aussi). Il porte un gros collier rouge avec une boucle où attacher une laisse qui n’est pas figurée, comme si la docilité de l’animal la rendait inutile. On l’imagine reniflant les chausses de son maître, à moins que ce ne soit la corneille qui l’intéresse.
Le deuxième blaireau qui apparait derrière lui semble sur le point de se transformer tout à fait en chien : le noir s’arrête à l’œil, le museau droit n’évoque plus le blaireau, et il redresse la tête vers son maître comme pour quémander un biscuit.
Qu’est-ce que tout cela peut bien signifier ?
Avoir comme animaux de compagnie des animaux sauvages est évidemment une marque de richesse, avoir choisi des blaireaux – dont la représentation dans la peinture de la Renaissance ne semble pas courante – peut y ajouter une marque d’originalité. Est-ce une façon de dire : « Je suis un être des lisières et de la nuit, même si vous me voyez en pleine lumière dans cette fresque pieuse je me moque bien de ces apparats et de ces miracles ? » Faut-il y voir, comme le fait Daniel Heath Justice, « une plaisanterie sexuelle insolente au spectateur, étant donné que le blaireau sans collier regarde la zone génitale de l’artiste tandis que le visage de Sodoma affiche un sourire ironique et complice » ? (« Perhaps Sodoma is having a cheeky sexual joke on the viewer, given that the unbound badger is peering up at the artist’s genital area while Sodoma’s visage sports a wry and knowing smile. ») Les blaireaux seraient-ils ici un outil de séduction crypté dirigé vers le garçon aux longs cheveux blonds et en tenue légère qui apparait sur la droite ?
Une chose est sûre : ces blaireaux-là ne sont pas à leur place, ils n’ont pas été représentés pour eux-mêmes, en tant que blaireaux, et le peintre ne leur donne une étrange visibilité que pour effacer derrière une symbolique obscure la réalité de leur vie animale.
26/07/25