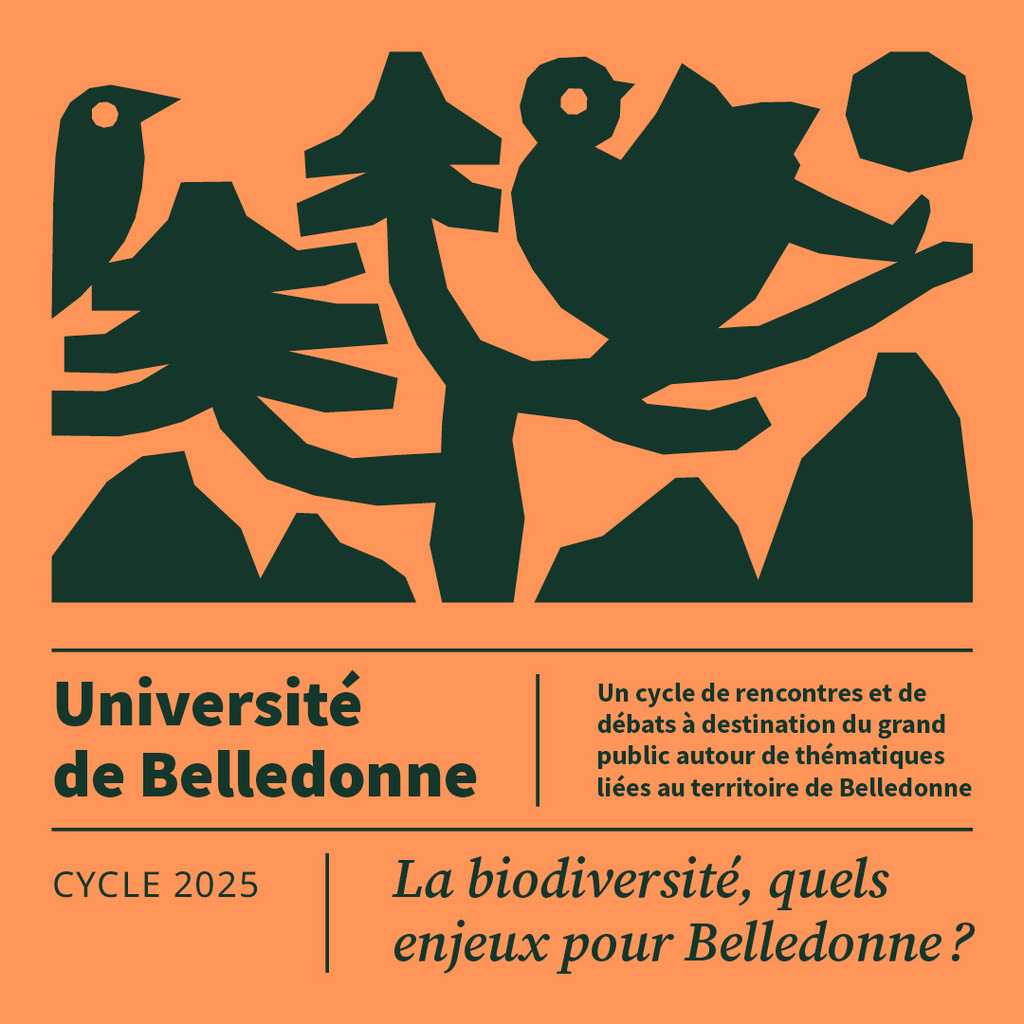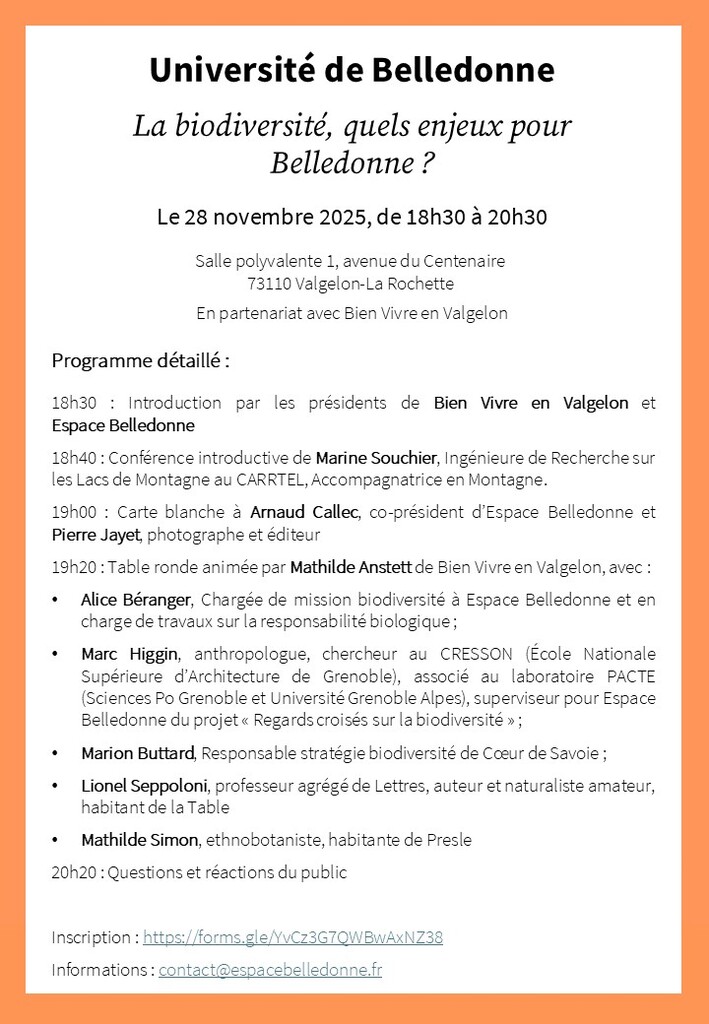Le blaireau invisible

Invisibles, les blaireaux le restent depuis qu’a commencé cette sècheresse qui amenuise les chances de survie des blaireautins. Je suis inquiet, à cause de cette page, la 134, chapitre « Le sentier de la mort », dans Le blaireau d’Eurasie d’Emmanuel Do Linh Sahn, qui montre un crâne de blaireau encore à moitié recouvert de poils avec cette légende : « Lors des étés secs, de nombreux blaireautins meurent de famine. » J’avoue en avoir cauchemardé… (Sans doute est-il dérisoire de se préoccuper ainsi de blaireaux qui sont d’ailleurs probablement bien vivants quand, au même moment, des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes meurent de faim dans la bande de Gaza pilonnée par l’armée israélienne, mais je ne choisis pas mes cauchemars compassionnels qui mêlent sans vergogne les souffrances.)
Les longues chenilles jaune pâle des fleurs de châtaignier cependant s’entassent devant les entrées du terrier, signalant mieux que toute toile d’araignée leur abandon. Des mulots forestiers entrent, sortent, se faufilent entre débris et racines, leurs museaux parfois chargés de glands démesurés qu’ils se dépêchent d’enterrer. La nuit dernière, le piège photographique n°3 a saisi à l’entrée du terrier périphérique n°2 (voir « Au milimètre près » ci-après pour la localisation) l’image d’une hulotte qui venait manifestement de rater l’un d’entre eux. Elle a tourné la tête dans un sens, dans l’autre, comme étonnée de son loupé, puis elle s’est envolée dans un si grand silence qu’on aurait pu croire à une panne de micro. Comme le remarque Jérôme Sueur dans son Histoire naturelle du silence, c’est ainsi avec les chouettes. « L’œil dit : un animal passe. L’oreille dit : rien. » C’est là un mystère explicable, puisque (précise Jérôme Sueur) « le vol silencieux de ces oiseaux est dû aux propriétés structurelles des ailes : leur taille, leur forme, l’agencement et les microstructures des plumes participent à la réduction des bruits aérodynamiques et de frottement ».
Les cris des blaireaux me manquent, alors je m’intéresse au silence des chouettes – tout en guettant.
De retour d’un concert en ville dans la nuit en surchauffe, je roule très lentement en surveillant les bas-côtés, car je traverse un lieu où l’on m’a signalé un blaireau écrasé récemment. En percuter un serait affreux, en voir un traverser merveilleux, mais ce soir-là je ne vois que deux renards et un chevreuil.
Ici comme partout sur les routes françaises, les sections où les animaux sauvages traversent fréquemment sont signalées par le panneau de danger A15B, qui représente la silhouette d’un grand cerf coiffé en train de bondir. En dehors du sanglier qui est parfois choisi, c’est le cerf coiffé qui conserve l’apanage de représenter tous les autres – le grand cerf aux grands bois, pas le cerf sans ramure ni la biche, ni le chevreuil (qui a pourtant belle allure et qu’on croise plus souvent), ni le superbe lynx boréal (dont la fragile expansion est rendue plus difficile encore par les collisions), ni le hérisson, ni la chauve-souris (« protégés » sur le papier seulement), ni le loup (trop haï, les panneaux seraient mitraillés…), ni les rapaces diurnes ou nocturnes (pourtant souvent victimes mais plus imprévisibles), encore moins le renard, l’écureuil ou les mustélidés. D’autres pays proposent pourtant toutes sortes de déclinaisons graphiques, et la possibilité existe en France de varier le visuel sur les routes communales et nationales (mais pas encore les départementales) : on a vu apparaître timidement des panneaux mettant en garde contre le risque d’écraser les amphibiens, le lynx est apparu ici ou là sur les panneaux du Jura, et une municipalité bretonne a pris l’initiative de placer des panneaux représentant le hérisson, la chauve-souris, la salamandre, la grenouille et la loutre – mais partout ailleurs, seul le cerf semble assez noble pour qu’on daigne s’y intéresser, ou assez grand pour qu’on se dise qu’en percuter un pourrait envoyer la voiture à la casse et ses occupants, au mieux, à l’hôpital.
Le blaireau, qui paye pourtant l’un des plus lourds tributs aux collisions, fait partie de la cohorte des invisibilisés. Son joli masque bicolore n’a pas droit à l’image. L’installation de panneaux dédiés comme ceux que l’on trouve aux Pays-Bas fait partie des revendications du groupe « blaireau » de Pro Natura dans le canton de Genève, et je l’appelle évidemment de mes vœux. Indépendamment de l’impact éventuel sur le nombre de collisions, une telle reconnaissance de son importance permettrait à tous les automobilistes de graver sur leur rétine le motif si frappant du « badger » – la marque, le masque, le « badge ». Mais un blaireau ? N’y pensons pas ! D’ailleurs, c’est vrai : personne ne pense au blaireau.
J’ai vérifié. La couverture des éditions anglaises aussi bien que des traductions françaises, allemandes, espagnoles, italiennes, du livre de Charles Foster Dans la peau d’une bête, représente toujours un cerf couronné, ou un renard pour les rééditions de poche. Pourquoi pas ? Il y a en effet un chapitre où Foster tente, avec l’humour et le sérieux qu’on lui connaît, de se mettre dans la peau d’un cerf, un autre dans celle du renard des villes ; mais le plus long de tous, celui qui est objectivement le plus réussi et qui devrait en toute logique avoir la préséance, est celui qu’il consacre au blaireau ! Le cerf et le renard ont été jugés plus vendeurs…
In-vi-si-ble.
Comme j’étais tantôt allongé sur une table de massage pour soigner mes dernières contusions (la pente où le terrier a été creusé est glissante et je m’y casse régulièrement la figure), l’ostéopathe qui tentait de me faire parler de mon travail d’enseignant s’est exclamée : « Savez-vous que c’est la première fois qu’un patient prononce ici le mot mustélidé ? » Je m’en doutais ! Et le mot « Blaireau » ?
Inaudible. (Je vais partir en Grande-Bretagne.)
Une personne (que par ailleurs j’estime) me demandait, il y a quelques jours, ce que j’allais faire pendant mes vacances. « Eh bien, chercher les blaireaux ! », ai-je répondu du tac au tac. Cette simple phrase a tout bonnement fait dérailler le train de la conversation : elle a perdu contenance, s’est mise à chercher désespérément quelque chose à répondre, une question à poser, sans parvenir à rattacher ce mot de « blaireau » à une réalité tangible. Elle a bredouillé et puis, comme si je n’avais rien dit, ou comme s’il était plus poli, devant l’incongruité totale de ma parole, de faire comme si elle n’avait rien entendu : « Moi je retourne en Italie ! »
Inexistant ! (L’Italie est un beau pays, le blaireau y est protégé !)
Il y a bien quelquefois de vraies surprises, quand le blaireau se trouve soudain mêlé au plus fort de la vie, de la mort, aux étonnements, aux accidents. J’ai discuté encore pendant un pot de départ avec une ancienne collègue. Passées les premières secondes de palabres inutiles, j’en suis venu à aborder le seul sujet qui vaille, et voici qu’elle m’a répondu : « Oh, le blaireau !… C’est quand même incroyable que la blairelle puisse différer l’implantation de l’œuf comme elle le veut afin que tous les petits naissent au printemps, tu ne trouves pas ? »
Les bras m’en sont tombés.
« Tu sais, il n’y a pas tant de gens qui, lorsque je leur parle de blaireaux, me sortent tout de go cette histoire d’ovo-implantation différée, que les naturalistes ne connaissent pas depuis si longtemps ! Comment sais-tu une chose pareille ?
— J’ai lu autrefois un excellent livre sur le sujet.
— Tu te souviens du titre ?
— Non, c’était il y a longtemps… Je l’aime beaucoup, le blaireau, même s’il est associé à un malheur.
— Que s’est-il passé ?
— Mon fils autrefois, en moto, en a percuté un sur une départementale et a eu un grave accident dont il a gardé des séquelles… »
Mais habituellement, le blaireau à l’instar des neuro-atypiques, des « racisé.es » et des ostracisé.es de tous poils, fait partie des minorités invisibilisées. Il n’a même pas son étendard, aucune association en France qui en ait fait son emblème (le renard pour l’ASPAS, le macareux pour la LPO – ah, il figure tout de même en compagnie de la pie et du renard sur le logo d’AVES, je l’ai sur un tee-shirt !). Une amie très militante à qui je disais mon désir d’intégrer les méliphiles (ou « badger lovers ») au sigle à mon avis trop étroit des LGBTQIA+, a mal pris ce qu’elle a pensé être une raillerie. Elle a cru bon de m’expliquer doctement que ça n’avait rien à voir, puisque, « rassure-moi, il n’y a rien de sexuel entre les blaireaux et toi ? », mais non, évidemment, mais il faut bien faire passer la frustration de ne plus les voir en parlant au moins d’eux et les militant.e.s avec leurs discours sans fin sont pires que les autistes mélimanes… (ai-je pensé sans le dire.)
Marginalisé, et pire : renvoyé en dehors de la marge, où se terre le sauvage.
C’est bien ma veine, que de m’être amouraché d’un mustélidé souterrain (double handicap) : ce n’est pas grâce à lui que je vais pouvoir accéder à la célébrité publique (à laquelle, ça tombe bien, je n’aspire pas). En 1990, la grande Colette Magny avait consacré tout un disque et un spectacle (qui, si elle en avait eu les moyens, aurait dû être un opéra) à la Pintade, Kevork : je revois la tête de l’animateur de télévision qui avait eu le bon goût de l’invité pour chanter quelques standards de jazz, mais dont la bonne volonté ne pouvait aller jusqu’à lui laisser célébrer son volatile à la télévision publique ; Colette, mes blairelles et mes blaireaux sont solidaires de tes pintades pour protester, « parias de tous les pays… »
C’est sans espoir.
Mais voici que je me suis mis en tête d’écrire un livre sur lui, avec lui – un livre dont le titre serait : Ceux que nous cachait la nuit. Autant viser d’emblée l’auto-édition, ou bien une traduction en anglais (mais les Anglais sont bien lotis en études fouillées et livres pertinents).
J’ai pourtant bien l’intention de m’obstiner, d’abord parce que c’est la seule façon que j’ai trouvée de faire quelque chose à partir de mes manies, ensuite parce que cela me permet de continuer à être avec eux malgré leur absence, et puis enfin parce que parler du blaireau, de la blairelle et des blaireautins, peut être malgré toute une façon plaisante et non-violente de les sortir du terrier de notre ignorance humaine et sans les éblouir de les mettre en lumière.
Par-delà le blaireau, ce sont tous les invisibles qu’il faudrait rendre visibles. On a trouvé les budgets pour changer tous les panneaux 90 en panneaux 80, puis pour remettre des panneaux 90 sur nos routes ; allons-y pour de nouveaux panneaux, sur toutes les routes de France qui traversent les champs et les bois : attention, traversée de blaireaux, de blairelles, de blaireautins (silhouette à chaque fois), attention, traversée de renardes et de renards, de chevreuils, de chevrettes et de faons, de sangliers, de laies et de marcassins, de buses, de chouettes, de faucons, de chauves-souris, de hérissons, de salamandres, de tritons, de grenouilles rousses, agiles, vertes, d’hermines, de belettes, de fouines, de martres, de putois, de lynx, de serpents, etc. etc., « mais il y a tout ça chez nous maman-papa ? — Hé oui, il y a tout ça, enfin il y avait… », et comme cela ne viendra jamais des pouvoirs publics, il ne reste plus qu’à planter soi-même panneaux et pancartes long des routes.
Ou à écrire des livres…
02/07/25