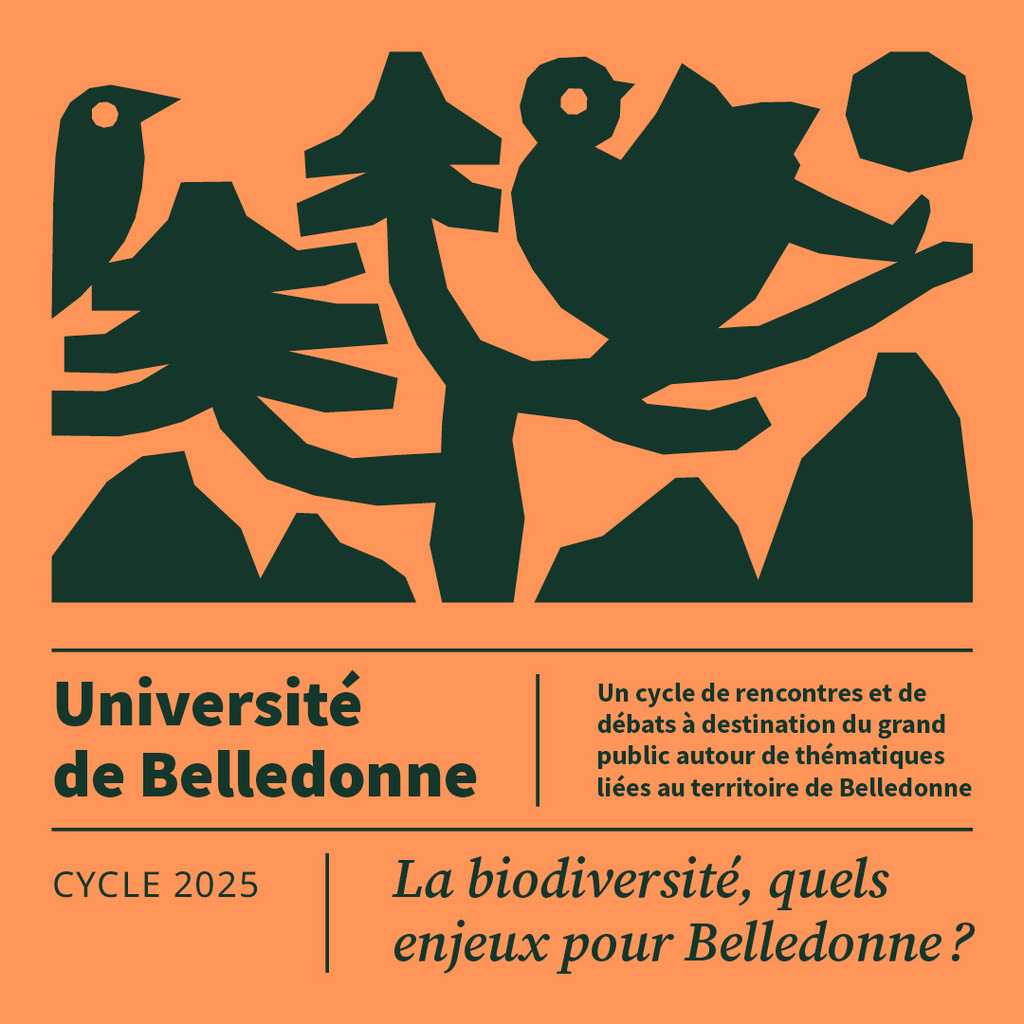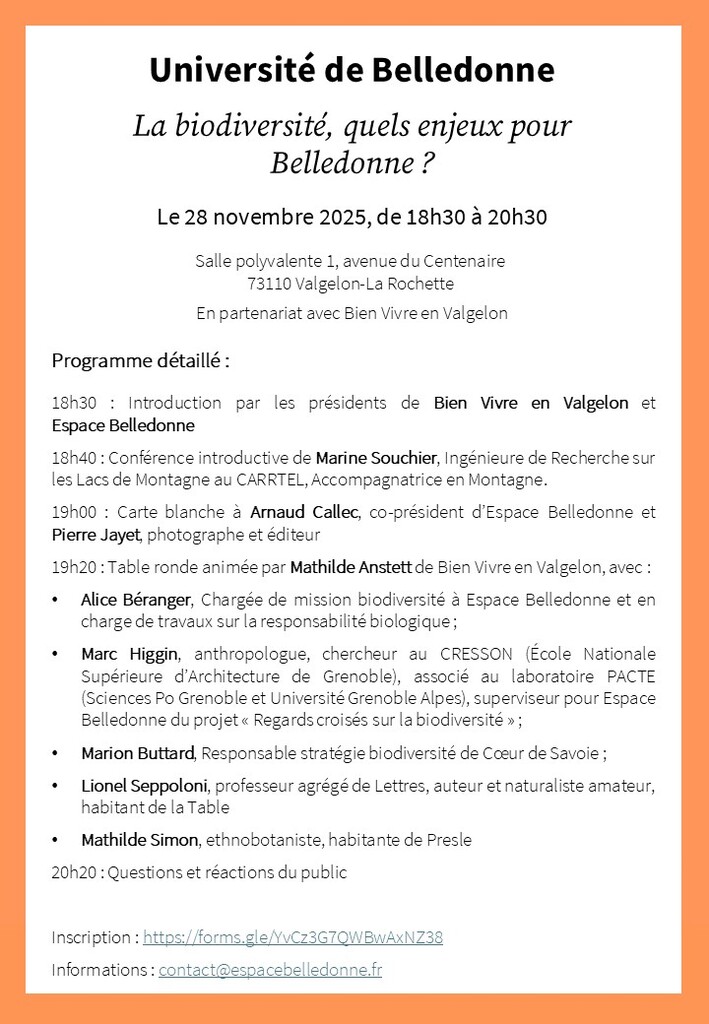Un soir avec les chauves-souris

Que deviennent le rêveur quand le rêve est fini, et le journal d’un méliphile lorsque Meles s’en est allé ?
Ce soir encore je rôde dans la forêt desséchée qui ressemble de moins en moins à une forêt. Au-dessus du terrier périphérique 02, la masse des épicéas décharnés semble un jeu de mikado pour géant – mais à bien y regarder, ce n’est pas un jeu et ce n’est pas drôle, car on dirait plutôt que les arbres ont été placés ainsi uniquement pour faciliter un départ de feu. Une étincelle et ce serait l’embrasement assuré, qui menacerait les hameaux des Landaz et de La Martinette ; quant au terrier, il serait au cœur de la fournaise…
Mais même sans attendre l’éventuel incendie, la canicule a d’ores et déjà entamé l’habitabilité du lieu. Presque aucun animal ne passe plus par ici. Un renard furtif remonte du torrent et passe sans voir l’humain, préoccupé peut-être. Je quitte le sous-bois déprimant et m’assois en lisière.
Dans le grand champ en contrebas une chevrette est occupée à brouter. La condition d’herbivore est peut-être encore la moins mauvaise, pendant la canicule. Ce qui frappe cependant, c’est l’incroyable pauvreté de ces champs moissonnés ou pâturés, les vaches ne laissant derrière elles qu’un sol défoncé, la terre presque à nu, sans une fleur, on dirait sans insectes. Je fais pour me rassurer l’inventaire des fleurs survivantes et trouve quelques scabieuses pas très épanouies, des mauves pâlichonnes, les fleurs du liseron et des œillets éparpillées dans la paille, de rares bouillons noirs qui surplombent l’herbe rase comme des tours d’habitation dans une ville basse et servent habituellement de refuge aux insectes (mais à cette heure, personne ne butine), un peu de trèfle, quelques marguerites, les ombelles ouvragées de la carotte sauvage qui luisent dans le soir… Ce n’est pas si mal. La floraison des châtaigniers surtout est superbe, cette année, mais ce sont les abeilles des ruches humaines qui s’accaparent cette manne après s’être accaparées les riches pissenlits.
Même ici, dans cette vallée qui semble préservée, c’est l’animal humain qui capte presque toutes les ressources : l’herbe pour les troupeaux, les troupeaux pour la viande et le lait ; les fleurs pour ses abeilles, ses abeilles pour le miel ; les rus pour ses barrages, le ciel pour ses avions, et si l’on ferme les yeux on n’entend encore que les clarines, le cri du paon domestique, une moto au pot probablement crevé qui remonte la route…
Franchement, ils ont bien fait de déménager, les blaireaux, de quitter ce lieu mort.
Soudain, un son très aigu qui passe à toute vitesse de mon tympan droit à mon tympan gauche et qu’accompagne un froissement d’ailes m’arrache à mes songeries maussades. Se découpant nettement sur le ciel encore clair, voici une première chauve-souris.
Je sais que, dans les bandes dessinées et l’imagerie populaire, la représentation de chauves-souris est associée aux humeurs négatives, mais ce n’est pas du tout ainsi que je la perçois, au contraire, car ses virevoltes sophistiquées me rappellent aussitôt à la vie, en l’occurrence à celle de ces insectes que je ne voyais pas, que je ne peux toujours pas voir, mais dont elle est en train de faire son repas.
Presque aussitôt, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième chauve-souris rejoignent le ballet, et puis d’autres encore. Je connais mal les chauves-souris, mais on distingue trois tailles différentes qui correspondent vraisemblablement à trois espèces : de toutes petites que je suppose être des pipistrelles ; des moyennes, que j’associe arbitrairement au nom de « murin » ; et puis, arrivées en dernier, des chauves-souris beaucoup plus grandes, dont j’admire la valse imprévisible sans oser les nommer.
Je les regarde et je voyage. Je songe avec nostalgie à l’immense roussette qui, des années durant, dormait le jour et mangeait ses fruits la nuit au-dessus de ma table de travail sur le balcon de notre maison guyanaise. Dans Les fantômes de la nuit, Laurent Tillon raconte, entre autres choses inouïes, la capacité qu’ont les grandes noctules à attraper des passereaux migrateurs en vol, à s’élever alors très haut dans le ciel avec leur proie pour éviter les risques de collision (puisque, bouches fermées, elles ne peuvent plus se servir de l’écholocation) avant de se laisser tomber en dévorant l’oiseau enfermé dans leurs ailes dont elles abandonnent les restes quand le sol se rapproche. Il raconte également la chasse en meute, comme des loups, de ces mammifères prodigieux dont Buffon disait que le « mouvement dans l’air est moins un vol qu’une espèce de voltigement incertain qu’elles semblent n’exécuter que par effort et d’une manière gauche » – ce qui prouve simplement qu’il n’avait jamais regardé les chauves-souris voler, car il est évident que le groupe que j’ai sous les yeux fait preuve d’une assurance et d’une virtuosité sans pareil…
Quand Meles n’est pas là, le méliphile peut se rabattre sur les chauves-souris. Et puis, sur cette idée que, l’un dans l’autre, même si cela vient bien tard et ne peut seulement atténuer l’ampleur et la rapidité de la grande extinction en cours, jamais l’homme n’a encore été en capacité de voir le monde et les autres animaux comme il peut le faire aujourd’hui, en alliant compréhension intellectuelle et sensible, étude et émerveillement, avec tout ce que cela entraîne de conscience à la fois de la prodigieuse altérité et des liens non moins fascinants qui nous relient aux autres coloca-terres. On commence à connaître ceux que la nuit cachait.
Comme chante cruellement Dominique A : « La vie rend modeste, on voit ce qu’on avait quand on voit ce qui reste. »
04/07/25