Meles meles en marge des lettres : du côté des écrivains
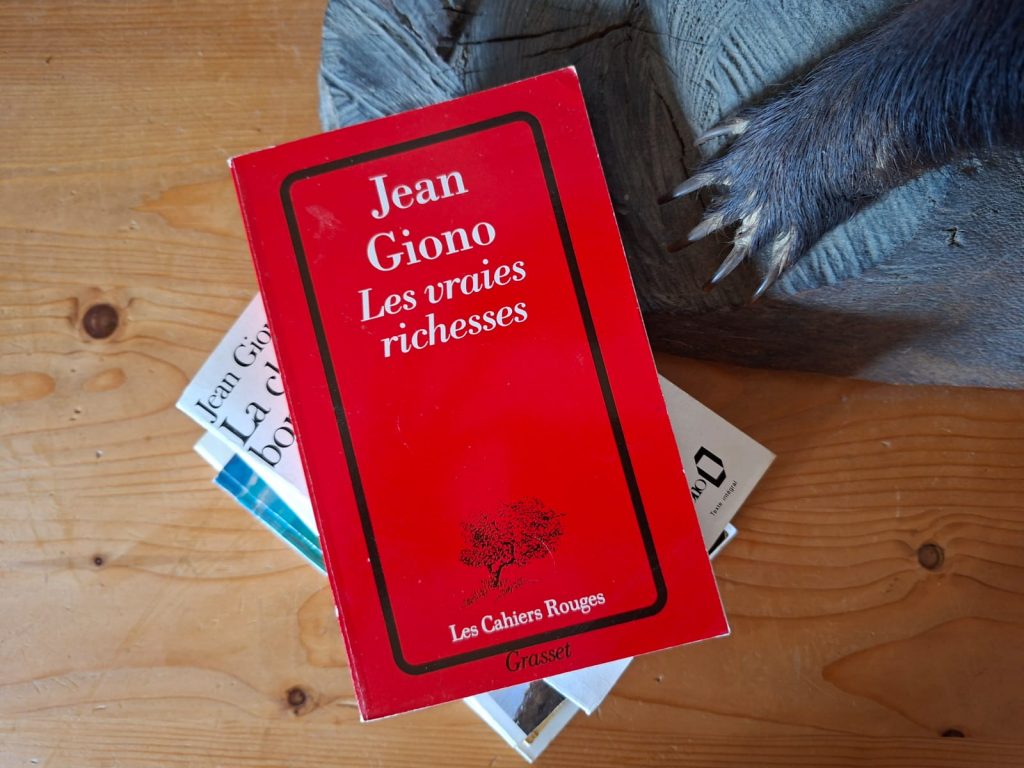
Comme il fait jour et que je suis las de m’écorcher aux ronces en quête de terriers, je reviens à ce qui est en principe mon champ de compétence et d’intérêt premier : les lettres françaises. Après tout, la littérature, avec cette exigence formelle qu’elle suppose, n’est-elle pas censée permettre de « découvrir » et d’ « éclaircir » comme une lampe ou le verre des lunettes tous les aspects de nos vies ainsi « pleinement vécues[s] », Proust dixit ? Sinon, à quoi bon ?
Bon, je ne suis pas naïf, et je sais d’emblée que si la littérature en général et la française en particulier excelle dans l’exploration socio-psychologique, elle est historiquement cantonnée à l’humain et que, par conséquent, l’infinie complexité des mondes animaux et des relations que nous pouvons ou que nous pourrions entretenir avec eux, lui échappe complètement. Le simple fait de risquer ce genre d’approche fait de vous un renégat des lettres…
Je veux quand même vérifier et puis, chercher dans les marges, arpenter les lisières. Il faut dire qu’il est drôle, pour un lettré méliphile, de parcourir ces livres justement estimés et dont beaucoup me sont chers avec ce seul critère de la présence ou de l’absence du mot « blaireau » ! C’est à la fois prodigieusement réducteur, il va sans dire, et en même temps cela confirme l’absence quasi généralisée de la faune sauvage dans nos lettres, et du blaireau en particulier. Le Trésor de la Langue Français Informatisée précise la « fréquence absolue littéraire » des mots en se basant sur un échantillon représentatif de la littérature des XIXe et XXe siècle. Le mot « blaireau » n’est crédité que de 140 occurrences, ce qui, grâce sans doute à la confusion entre l’animal, l’instrument à barbe et l’insulte, est mieux que « putois » (39) mais pire que « loutre », « hermine », « chevreuil », « sanglier », « cerf », « renard » et « loup » (ce dernier atteint 2031 occurrences en fréquence absolue littéraire, avec un net accroissement au XXème siècle).
Ce ne sont cependant que des statistiques, et il faut regarder de plus près, du côté d’auteurs ayant évoqué le monde rural ou décrit si peu que ce soit la nature « ordinaire ».
Les recherches s’avèrent rapidement aussi désespérantes que trois nuits d’affût devant un terrier vide.
Il n’y a pas un blaireau dans toute l’œuvre de Rousseau, ni dans La Terre de Zola, ni chez Les paysans de Balzac, ni d’ailleurs dans l’ensemble de La Comédie Humaine et des Rougon-Macquart. Les milliers de pages de La recherche du temps perdu n’en comptabilisent pas davantage, il faut croire que les promenades proustiennes du côté de Guermantes ou de Méséglises, en ce jardin extraordinaire où le narrateur croise Gilberte pour la première fois et semble fixer dans sa mémoire les noms de toutes les fleurs qu’il se remémore plusieurs décennies plus tard, aucun blaireau n’a jamais creusé son terrier. Je ne trouve rien non plus dans le Bestiaire enchanté ou La dernière harde de Maurice Genevoix, ni chez Colette, qui décrit pourtant parfois avec tant de finesse des sensations forestières et des lieux aimés de la campagne, ni chez Butor, Cendrars, Delteil…
Il n’y a pas en France comme en Suisse ou dans les pays anglo-saxons de tradition d’écriture naturaliste, pas de Rachel Carlson (dont on peut lire encore les livres parce qu’ils sont portés par une parole puissamment poétique), pas de Seton, de Thoreau, ni même de Paul Géroudet, cet ornithologue helvétique dont les descriptions d’oiseaux ancrés dans un lieu et un moment précis mériteraient de figurer dans toutes les anthologies littéraires. Il y a néanmoins quelques cas isolés, dont celui de l’entomologiste Jean-Henri Fabre, chez qui je déterre enfin, si j’ose dire, mes deux premiers blaireau.
Jean-Henri Fabre écrit dans un style ample, précis et suggestif, si bien que ses livres ont gardé la capacité à transmettre de façon vive les sensations et les émotions propres à l’observation du monde sauvage. Les deux passages concernés, dans Éléments d’histoire naturelle des animaux (1881), sont cependant des plus décevants. Le premier évoque le renard qui s’empare « du domicile souterrain d’un blaireau, qu’il force à déloger par l’infection de son urine » – ce qui, on le sait, est une croyance obsolète, le blaireau supportant assez bien la proximité du renard (mais pas des renardeaux qui, en effet, peuvent le pousser à s’en aller). Le deuxième associe le blaireau non aux mustélidés mais aux ours, et précise que cet animal « de la taille du chien basset et comme lui à jambes courtes » a des « poils élastiques et souples [qui] servent à faire des pinceaux. »
Le découragement me vient. Non, Jean-Henri, les poils du blaireau servent à le protéger du froid, des morsures, entre autres choses fort utiles quand on est un blaireau.
En désespoir de cause, je cherche sur le net des citations qui pourraient m’aiguiller, et trouve chez Pascal Quignard, dans Rhétorique spéculative, cette comparaison particulièrement mal venu à propos d’une espèce singulièrement sociable : « Rares sont les espèces qui échappent à toute vie collective : le vison, le léopard, la martre, le blaireau, moi. »
Pas facile, pour un auteur français, d’oublier un peu le « moi » pour regarder ailleurs.
Je n’imagine pourtant pas que Julien Gracq, du haut de son Balcon en forêt, n’ait pas vu passer les blaireaux : nulle mention, pourtant, rien ! Et ses Carnets du Grand Chemin, qui ont fait mon bonheur autrefois ? Le blaireau y fait une seule apparition, associé à l’idée que l’écrivain ne peut pas plus être extirpé de sa langue que le blaireau à son terrier : « Quand je lis le Nabokov critique, passe jusqu’à moi chaque fois le bienheureux désespoir qu’il ressent de ne pouvoir transmettre à l’auditeur ou au lecteur le bonheur de langue, la félicité littéraire native propre à Gogol ou à Pouchkine, le sentiment que de tels écrivains sont terrés dans leur langue, et aussi puissamment crochés en elle, des dents et des ongles, que le blaireau dans son réduit. »
Pas facile, pour un auteur français, d’oublier un peu l’écriture pour regarder ailleurs.
Je me décide à aller voir du côté de la littérature « de terroir », la seule peut-être où le blaireau semble pouvoir occuper une modeste place, puisque même La Fontaine l’a oublié dans ses fables (j’ai de toute façon mis d’emblée de côté les ouvrages où le blaireau n’est qu’un masque animal sur un personnage humain, comme dans Le roman de Renart, ainsi que la littérature jeunesse dont je parlerai après).
Je ne sais pas si l’on peut dire que Marcel Pagnol se situe « en marge des lettres » ; disons que je ne fais pas grand cas de ses livres qui donnent de la Provence une image de carte postale, et que seule la recherche des si rares traces laissées par le blaireau dans la littérature m’a fait ouvrir Le château de ma mère (1960). Il y est en effet brièvement question d’un animal « détérioré » (déterré), ainsi que d’un mangeur de blaireaux. Voici le passage :
Dès qu’il m’aperçut, Paul se leva et courut à ma rencontre pour m’annoncer que les chasseurs avaient détérioré un blaireau, c’est-à-dire qu’ils avaient passé la matinée à extraire cet animal de son terrier. Ce trophée était suspendu à la basse branche du figuier par les pattes de derrière : c’était une sorte de petit cochon cousu dans une peau d’ours. Il était laid et puait horriblement. Je l’admirai un instant à haute voix, afin d’obtenir l’indulgence des chasseurs pour mon retard. L’oncle Jules m’annonça, avec une fierté joviale, qu’il l’avait « séché sur place » avec une charge de chevrotines dans la nuque. La tante Rose, au lieu de le féliciter, déclara qu’il était urgent d’enterrer ce cadavre qui attirait déjà les mouches bleues, et qui ne pouvait servir à rien. J’affirmai alors que François le mangerait de grand appétit, et ce meurtre inutile fut aussitôt justifié, à la grande satisfaction de l’oncle Jules.
On retrouve tous les clichés propres à la représentation du blaireau vu au prisme de la chasse : le rapprochement avec le cochon et l’ours, la puanteur, et cette « laideur » qu’on « admire ». Je note la mise à distance opérée par « tante Rose », et la satisfaction du chasseur devant la justification proposée par l’enfant à ce qui est qualifié de « meurtre inutile » : l’oncle Jules, qui se vante ailleurs de consommer toutes les bêtes, pourra en faire son repas.
Alors, pourquoi le tuer ? Est-il vraiment si difficile d’imaginer une autre manière d’entrer en relation avec le blaireau ? Y-t-il quelque part dans les livres un blaireau vif qui se promène ?
Le salut ne viendra pas du livre d’Éric Chevillard qu’entre temps, dans le blanc qui sépare ce paragraphe du précédent, je viens de terminer : L’autofictif repousse du pied un blaireau mort (2021). Tout de même, il faut le souligner, voici enfin un auteur français vraiment littéraire (publié chez Minuit ou Fata Morgana, de ceux qui font des lectures dans les Maisons de la poésie et s’en moquent un peu sans s’en moquer vraiment), qui a laissé entrer un blaireau à l’intérieur d’un de ses livres ! Les temps changent. Les animaux commencent à exister dans les lettres française et même, je n’en crois pas mes yeux : il y a le mot « blaireau » sur la couverture du livre, en blanc sur fond noir, et même, une silhouette qui évoque l’animal !…
L’« autofictif », c’est ici l’écrivain qui raconte sans raconter sa vie à travers des aphorismes parfois très drôles, volontiers absurdes, pas trop sentencieux, où les non-humains parfois s’immiscent sous la forme d’un scutigère véloce dans la salle de bain, d’une loutre, d’un hérisson ou, donc, d’un blaireau repoussé du pied sur la route. Voici le passage clé, en date du 28 juillet :
C’est parce que l’automobiliste qui l’avait percuté avait laissé son corps sur la route malgré le risque d’accident que j’ai repoussé du pied, sur le bas-côté, ce blaireau mort. C’était la première fois que je repoussais du pied un blaireau mort et je cherche maintenant d’autres personnes qui auraient vécu ça elles aussi afin de créer un groupe de parole pour partager notre expérience et ce qui en a résulté.
Cette expérience l’a suffisamment marqué pour qu’il y revienne le 22 juillet, en associant le blaireau à la peur de la mort (« Cette vie… ! Car voilà maintenant – ai-je l’habitude de mentir ? – que je me surprends à repousser du pied un blaireau mort. »), puis le 28 août. Le 12 septembre, il précise qu’il a observé l’animal avec « affliction et curiosité » :
Mon alibi tient la route, lui : je ne conduis pas. Or ce blaireau a été percuté par une voiture. Je me suis penché sur la bête déjà raide et enflée par les gaz, je l’ai observée avec affliction et curiosité, comme nous faisons toujours des cadavres, puis je l’ai repoussée du pied sur le talus, comme nous faisons plus occasionnellement.
Que cette anecdote ait été choisie comme titre donne une idée de l’incongruité qu’il y a à évoquer le blaireau dans les lettres françaises (là où le mot « badger » est fièrement mis en avant dans le monde anglo-saxon). Ce titre est accrocheur parce qu’il ne peut apparaître que comme totalement absurde, à première lecture – et ce d’autant plus qu’on ne sait si « repousse » est un verbe ou un nom. Il résume bien par ailleurs l’absence de rapport avec notre animal, repoussé du pied sur le bas-côté après avoir été percuté par une voiture. Le malaise qui s’en suit est-il lié simplement au sentiment universellement humain de la peur de la mort (le thème est omniprésent dans le livre), ou bien lié de façon plus précise à notre mustélidé ? L’auteur semble esquisser la question le 16 septembre (« Et je me demande également, au cas où je serais amené un jour à repousser du pied un renard mort, si ma rencontre avec ce blaireau me serait en l’occurrence d’un quelconque secours, ou s’il me faudrait tout réinventer, partant de rien, ou presque… ? »), puis il esquive.
Un écrivain français ne va pas faire des recherches sur la mortalité routière chez Meles meles, non, ce n’est pas son travail (ou bien, il fait comme moi, il vire sa cuti, si j’ose dire, il devient méliphile). Ce n’est pas le blaireau qui l’intéresse en tant que tel, mais la mort.
Est-ce que le blaireau est condamné à mourir dans les lettres françaises ? Comme pour les chasseurs, un bon blaireau est un blaireau mort ?
J’épargne au lecteur qui me suivrait encore sur les pentes escarpées de ces recherches la liste de mes échecs, pour en venir à un détour qu’à dire vrai, je m’épargnerais volontiers, si l’IA qui supplante peu à peu les moteurs de recherche ne me remettait sans cesse sous les yeux ce titre de L’homme-chevreuil, sept ans de vie sauvage de Geoffroy Delorme (2021).
Dans ce livre qui applique à l’écrit les procédés ordinaires de manipulation narrative propres à nombre de documentaires animaliers, l’auteur raconte avoir passé plusieurs années à vivre dans les bois comme les chevreuils. Il ne le fait pas avec l’honnêteté humble et éclairée d’un Charles Foster, non : c’est un récit autocentré où la mièvrerie le dispute à la confusion. L’auteur raconte ainsi qu’à la suite d’une battue traumatisante, dans une forme un peu folle de néo-colonialisme inter-spécifique il apprend à ses « amis chevreuils » à avoir peur des chasseurs :
Pendant que les hommes se postent à intervalles réguliers le long des chemins pour la battue, j’emmène Sipointe près d’une fourgonnette afin de lui faire renifler les odeurs de la poudre et de la « mort » d’autres animaux tombés lors des chasses précédentes. (…) Je fais respirer à Sipointe le parfum d’un blouson enduit de téflon posé sur le rétroviseur d’un 4×4 et lui fais comprendre mon inquiétude, ma peur. Les effluves de transpiration que je dégage en raison du stress suffisent à lui faire comprendre le danger. Je veux lui faire associer cette odeur à la chasse. Nous passons ensuite près d’un mirador sur lequel je monte puis redescends plusieurs fois en poussant de petits cris réguliers, comme le font les jeunes pour appeler « maman » lorsqu’ils sont inquiets. Je veux qu’il assimile le fait qu’un humain peut se situer au-dessus de sa tête et que c’est inquiétant.
Passons. Ce qui m’intéresse, c’est de voir ce qu’il dit des blaireaux, car on ne peut pas prétendre avoir passé tant de nuits en forêt sans parler de blaireaux – et de fait, il en parle.
Un tout petit peu, quelques mentions à peine, aussi vagues que le reste. Dans sa forêt fantasmée, on trouve encore des « cavités creusées sur environ quatre-vingts centimètres de large et deux mètres de profondeur » qui sont restées hérissées de « pieux assassins » et qui « servaient autrefois à capturer renards et blaireaux ». Il croise un blaireau qui « remonte le chemin caillouteux en grognant et soufflant » et se dit « rassuré de le voir ainsi, car, de nature, les blaireaux sont toujours bourrus et ne semblent jamais satisfaits », remarque d’un anthropomorphisme qui semble tout droit sorti d’un livre du siècle dernier. Une information est donnée en passant sur l’ « implantation différée » commune au chevreuil et au blaireau, mais ce qui m’arrête vraiment est une photographie de deux blaireaux, assortie de cette légende : « Deux voisins. Fouillou et Mimine sont des blaireaux que je croisais régulièrement. Pour eux, je faisais partie des habitants de la forêt et ne présentais pas de danger. »
Que des animaux sauvages, chevreuils ou blaireaux, puissent s’habituer à la présence d’un humain qui vient rôder assez régulièrement près d’eux et dépose partout son odeur, qu’ils puissent même l’approcher et se laisser approcher, c’est l’évidence même ; que l’auteur ramène tout à lui, passe encore, il n’est pas le seul ; mais quand je pense aux heures nécessaires pour tenter d’individualiser de façon un tout petit peu fiable mes trois blaireaux à partir des images prises par les caméras, l’exaspération me vient devant tant de désinvolture. Au moins L’homme chevreuil incarne-t-il à la perfection ce que je ne veux pas faire : mentir pour me faire une place au soleil social sur le dos d’un animal en prenant le lecteur pour le gogo qu’il est parfois, il faut croire, puisque ce livre s’est vendu, et que j’en parle aussi…
Pour me calmer, je feuillette Son odeur après la pluie, parce que Cédric Sapin-Defour, lui, est un frère d’écriture, et voisin de surcroît, et qu’ils ont bien dû croiser des blaireaux tous les deux, son bouvier bernois Ubac et lui, me dis-je. Je retrouve le passage et prends Cédric en flagrant délit de probable canicentrisme : « Ubac (…) sympathise avec un couple de blaireaux, toujours décidé à n’encombrer sa vie d’aucune méfiance. » Allez, mon cher Cédric, avoue que du point de vue des blaireaux, ça ne peut pas passer ! Rimski et Nouchka, mes samoyèdes à moi, auraient bien envie de fourrer leurs museaux dans les terriers, c’est sûr, mais jamais les blaireaux ne pourraient les voir autrement que comme des agresseurs… Mais peut-être s’agissait-ils de deux blaireautins enclins à jouer ? Le livre n’en dit pas plus. Dans les toutes premières pages du suivant, le bouleversant Où les étoiles tombent, je note en revanche une association indirecte du couple magnifique formé par Cédric et Mathilde à un « couple de blaireaux fidèles » qui fait partie, avec les cerfs et les renards, de leurs « seuls voisins » de « la forêt du Villard » (oui, il y a beaucoup de Villard en Savoie). Un frère, vous dis-je !
J’allais arrêter là mes recherches et ce chapitre quand j’ai ressorti mes livres de Giono, le premier grand amour littéraire de mes dix ans. Je constate bientôt que les blaireaux, de vrais blaireaux vivants, montrent à plusieurs reprises leurs museaux dans les pages de Regain (1930), Que ma joie demeure (1935), L’eau vive (1943)…
À dire vrai, le blaireau n’apparaît souvent qu’associé dans des listes aux renards, aux sangliers, au « vieux loup », aux écureuils, aux couleuvres (Solitude de la pitié, 1932), voire à des animaux fantastiques dans la « grande nuit sous le signe du bestiaire » (Bestiaire, 1991). On trouve des échos aux vieilles croyances médiévales (« des blaireaux à museau de chien », Provence, 1953) ou à la vie paysanne et à la chasse (« Ça aurait pu être mère blaireau avec son ventre lourd qui flottait dans la fontaine de la lune », se dit l’homme devant le renard pendu « pour l’écorcher », Regain, 1930, ou bien cet autre qui, comme dans Pagnol, connait « le goût de tout un tas de viandes : du renard, du blaireau, du lézard, de la pie », Colline, 1929). Mais quand Giono évoque « le glissement des blaireaux » (Naissance de l’Odyssée, 1930) pour la première fois je le vois, « mon » blaireau, croqué en une seule expression comme Robert Hainard le croque en quelques traits, je le vois avec sa robe grise qui cache ses courtes pattes et donne en effet l’impression souvent qu’il glisse sur les feuilles. Quand, ailleurs, il évoque au contraire sa foulée « lourde » sur la terre molle, il apparait encore dans toute la sensualité de son pas, de ses traces, mon fouisseur de la nuit :
La foulée du blaireau est au contraire lourde : deux pattes tombant presque au même endroit l’une sur l’autre. Il semble qu’il n’y a rien d’autre, là, que l’avancée régulière d’une bête têtue. Mais si la terre est molle, si on regarde de près, si l’homme solitaire, après avoir écouté tous les bruits, se penche sur l’empreinte en retenant les craquements de ses membres, s’il reste là-dessus, penché, sachant lui aussi ce qu’est le nocturne, il verra combien de furtives convulsions dans l’empreinte de la patte qui ressemble à une main d’enfant affamé. Tout en marchant elle pétrissait la terre sans que ce soit un mouvement nécessaire à la marche. Le nocturne n’est pas suavité ou délices, ou tout ce qu’on a dit sur le chant du rossignol, c’est autre chose : (…) il est suavité. (L’eau vive)
Je n’ai trouvé aucun autre écrivain qui compare l’ « empreinte de la patte » du blaireau à « une main d’enfant affamé », mais depuis que je l’ai lue, cette phrase s’est si bien imprimée en moi que toute observation de la dite empreinte, qu’on associe classiquement à celle d’un ourson, me dit à la fois la douceur, la fragilité et l’avidité de celui qui marche parce qu’il est en quête de son festin de vers de terre, mêlées à la faim de contacts propre au petit humain qui joue dans la terre. La littérature méliphile s’inscrit en creux, en devenir, dans cette comparaison-là.
Et puis, au détour de L’eau vive toujours, avec quelle facilité Giono prend le point de vue des bêtes pour nous montrer le fayard (le hêtre) « chargé perpétuellement d’étoiles – et cette fois, ce sont tous les souvenirs d’affûts qui remontent, prennent sens, s’agrandissent :
Personne ne voit le fayard chargé perpétuellement d’étoiles. L’hermine seule, le blaireau ou la martre; la fouine ou le renard, le chevreuil qui laisse sur la terre trois doubles cornes pour ses quatre pattes.
Trois phrases de Regain (1930) rendent vie à Vara : « Une bête est venue jouer dans la prairie. Ce devait être une femelle de blaireau. Elle s’est mise sur le dos, le ventre en l’air, un beau ventre large et velouté comme la nuit et qui était plein et lourd. » Dans Que ma joie demeure (1935), c’est encore le ventre du blaireau qui attire l’attention de Giono, dont je jurerais cette fois qu’il a non seulement vu mais regardé les blaireaux en train de tracer leurs chemins quotidiens : « Des blaireaux marchaient dans les labours en traînant le ventre. Sous l’arbre fleuri le renard avait recommencé à sauter après les sauterelles. La lune descendait dans un col lointain de la montagne. » La rencontre du blaireau est « signe de l’harmonie retrouvée », mais aussi – et de façon plus sobre et moins facilement poétique, expression du bonheur d’être en vie, « vivant parmi les vivants » : « Moi, à quatre pattes, j’étais heureux à en grogner comme un blaireau » (L’eau vive).
Heureux comme blaireau !
Le blaireau, le blaireau vivant, entier, dans toute son animalité, sa sensualité, sa complexité, ses mystères, à peine mis en lumière, juste éclairé pour qu’on y voit un peu sans pour autant le faire fuir, le blaireau ainsi intégré au tissu des relations que nous entretenons avec le monde dans le respect de son altérité mais la connivence partagée entre frères mammifères, est encore devant nous. Un jour, dans cent ans peut-être, s’il y a encore des livres et des hommes pour les lire, même la nuit des lettres sera parcourue de blaireaux, et l’on s’étonnera qu’on ait pu si longtemps ne parler qu’entre soi, du ciel et de l’enfer, de mondes imaginaires, de la psyché et de l’histoire humaines, en se croyant si seuls au monde : Giono esquisse la voie de cette littérature capable d’accueillir d’autres formes de vie, agrandissant les nôtres.
07/08/25

