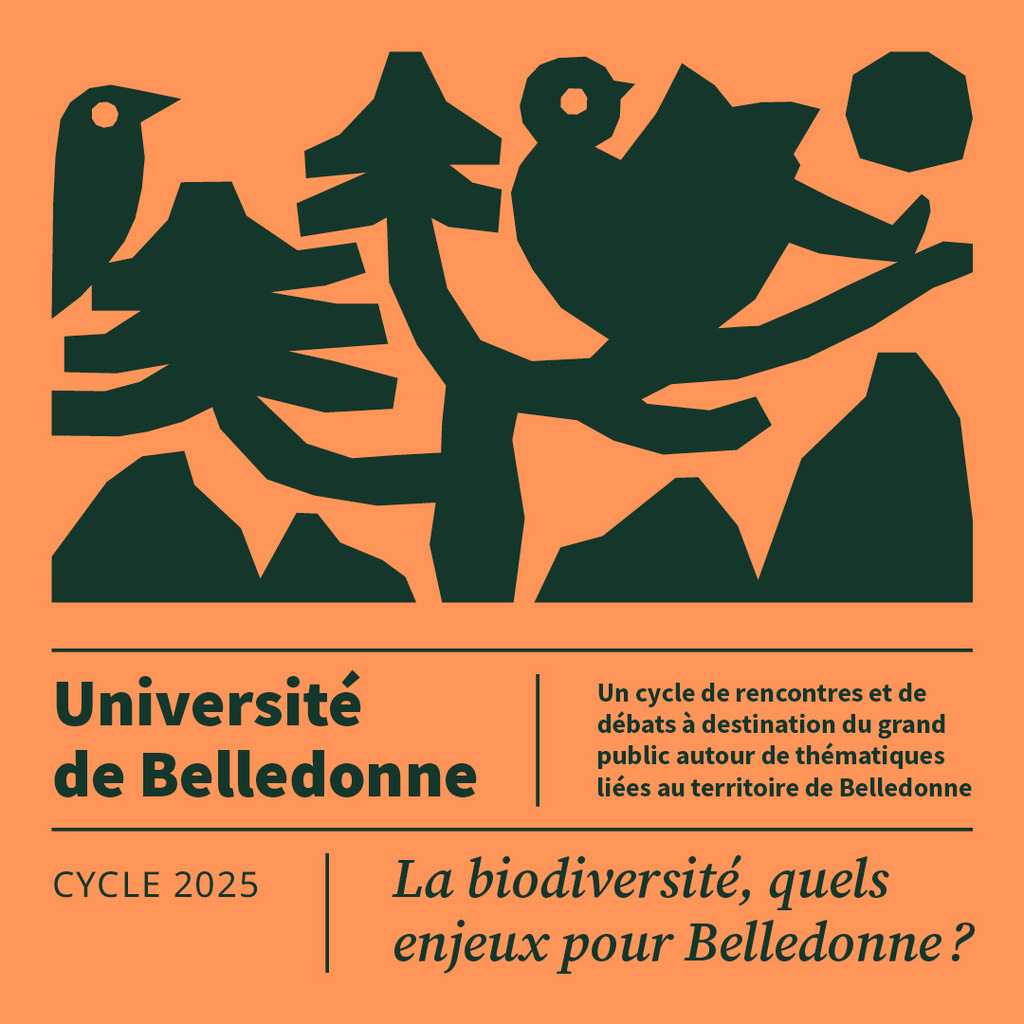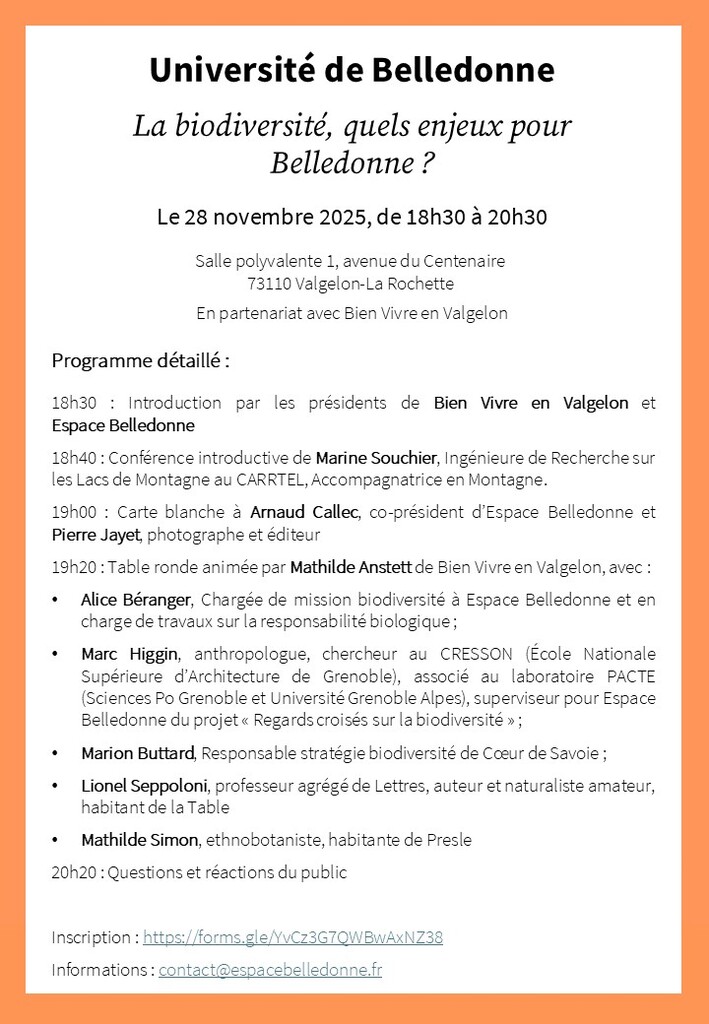Pensées éparses au gré de la marche

Parfois des paroles échangées en passant avec un voisin touchent terriblement, petits fragments d’humanité fragile dans l’air froid de décembre, comme des bougies aux fenêtres. D’ailleurs, aujourd’hui, peut-être à cause de toute cette humidité qui nous enserre, on est touché par un rien. Le croassement de la corneille qui traverse le ciel presque anthracite et va se percher au sommet de l’épicéa. La blessure du châtaignier cassé en deux. L’antique engin agricole tout rouillé, à la fonction obscure (peut-être une faneuse ?), qui était déjà là il y a dix-sept ans à mon arrivée (là depuis bien avant, mais je n’y étais pas).
Soudain deux chevreuils qui passaient en courant dans le bois, assez curieusement bifurquent vers nous, puis s’immobilisent à une quinzaine de mètres. Rimski tremble, Nouchka lance des appels déchirants. Eux, semblent hésiter. L’un je crois est un jeune chevrillard dont on voit les protubérances osseuses laissées par la chute des bois, le mois dernier ; l’autre est peut-être cette jeune femelle qui est venue montrer ses fesses (miroir en forme de cœur avec une touche de poils clairs au milieu) l’autre jour devant la caméra. Peut-être la chasse de ce matin les a-t-elle perturbés, ou bien est-ce notre présence : comment savoir ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent ?
Le livre sur les sangliers que je suis en train de lire, Sangliers, géographies d’un animal politique (il n’y en a pas sur le chevreuil dans cette collection) réussit à le faire ressentir au lecteur, en prenant si bien le point de vue de l’animal capturé qu’on sent presque le métal de la cage sur son groin. Comment dire ? Comment dire est une des questions portées par ce livre et d’autres de la collection Mondes sauvages. C’est en cela notamment qu’ils me semblent souvent s’inscrire dans une perspective géopoétique.
Je pense qu’il serait naïf de croire qu’un livre faisant mine d’épouser un point de vue non-humain, construisant donc une vision plus qu’humaine, est forcément un bon livre, a fortiori un livre meilleur que l’écrasante majorité de ceux qui se cantonnent à l’humain. « Les grands poèmes du ciel et de l’enfer ont été écrits, reste à écrire celui de la terre », disait, citation mille fois reprises, Wallace Steven. On a pour évoquer les sentiments et les relations humaines quelques siècles de vocabulaire à disposition. Ce peut être pesant, mais l’outil est déjà là, poli, efficace. Pour dire la vie des autres animaux, de la forêt, de la montagne, du « dehors » et de notre relation avec lui, c’est une autre paire de manches. On navigue à vue entre la froideur scientifique qui met trop de distance, mais dont le vocabulaire a le mérite de la précision, et l’anthropocentrisme au choix moralisateur, mièvre, déplacé. Je pense que le recours aux connaissances naturalistes est absolument nécessaire, mais elles sont si peu partagées qu’il faut des notes en bas de page ou de longues explications. Le maigre corpus de la littérature, disons, explicitement géopoétique, en pâtit, menacé de maigreur, de platitude, de déficit émotionnel ou de trop-plein informationnel — sans compter que les littérateurs ne font pas forcément de bons écologues et que, faute d’un savoir assez solide, les bourdes ou généralités abusives sont fréquentes.
Prendre conscience du fonds animal de nos capacités physiques et intellectuelles peut aider à dépasser cela. Il faudrait peut-être avant tout entrer dans les logiques bio et géophysiques à l’œuvre, mais à partir du corps. Si l’on parle de l’animal en animal, il faut partir de son corps, de ses sensations (comme celles de Rimski et Nouchka, occupés en ce moment à jouer les sangliers, justement, en grattant de toutes leurs forces la terre noire sous la neige et en fourrant leurs longs museaux faits pour ça dans le sol, traçant une ligne assez droite pour suivre le terrier du mulot qui ne doit pas être loin et commence sans doute à paniquer, aussi ne vais-je pas tarder à les interrompre). Partir du corps, des sensations donc, et puis remonter au fonds commun de nos émotions animales, de nos fragilités aussi, de nos individualités. C’est précisément ce que j’aime tant dans le livre de Jean-Louis Michelot Sur le Rhône : ce lien qui est fait entre le corps malade du fleuve et celui de l’auteur, la maladie ne débouchant pas sur une crue de souvenirs personnels mais sur une évocation à la fois poignante, suggestive et très documentée du Rhône parcouru des décennies durant par Jean-Louis – mais dans ce domaine, me dis-je encore en remontant une pente assez raide, mieux vaut être naturaliste plutôt qu’écrivain…
Je songe à la dernière lettre que m’avait envoyée Kenneth White, plus précisément à sa dernière partie, inhabituellement tapée à la machine alors que cet outil ne lui était pas familier et que les premiers feuillets avaient été écrits à la main – mais je suppose qu’il avait entretemps reçu des informations de nature à modifier sa façon de faire, ce que la brutalité du changement de ton et certaines formules toutes faites que j’ai trouvées récemment reprises telles quelles sous une autre plume pas plus aimable, montrait assez. Il m’avait vertement repris d’avoir osé parler de « sentiments du monde » plutôt que de « sensations » (pour lui, quiconque parle de « sentiments » verse dans le sentimentalisme…). Il me reprochait d’avoir forgé de mon propre chef un concept étranger à la géopoétique, cette expression de sentiments du monde renvoyant en fait de ma part au livre du poète Jean-Pierre Siméon (qui, par ailleurs, appréciait Kenneth White). De telles barrières me semblaient et me semblent profondément absurdes, mais je n’avais pas voulu ferrailler ni tenter un dialogue à laquelle cette lettre n’invitait pas. J’étais allé rôder plus loin, et depuis je médite un texte jamais écrit qui parlerait de géopoétique, de fragilité transhumaine et de « nouvelles alliances ».
10/12/24