INTÉRIEUR NEIGE
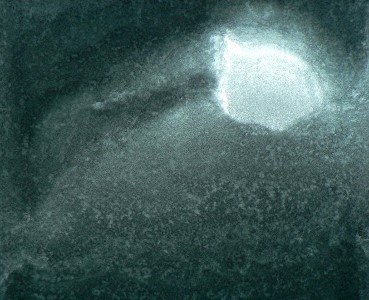
Ah ! ce tableau-là, cette lueur de grotte qui laisse pressentir au-delà de la vitre un paysage vraiment nouveau (ou plus de paysage), il faut avouer que tu avais continué à l’attendre avec une fébrilité peut-être enfantine, peut-être maladive.
Cette envie, parfois, que tout s’arrête.
Voici donc qu’au-dessus de la maison l’énorme masse de la montagne s’est une fois de plus alourdie de toute cette neige qui, tôt ou tard, ira rejoindre les rivières et le fleuve, mais qui reste pour l’instant en arrêt.
Le temps aussi semble arrêté.
Aucun bruit, même assourdi.
Pas un chant, pas un cri, et si les voitures circulent encore ce ne peut être qu’au pas.
La neige a rouvert une brèche dans l’ordre des agendas, et tu restes allongé au fond de ta crevasse (confortable, il est vrai).
Tu refermes les yeux et songes à l’effarement des bêtes, aux cerfs qui ont dû redescendre et dessinent déjà, en lisière du bois que tu longeras tout à l’heure, les ombres chinoises de leurs fresques mouvantes.
Tu songes aux hommes restés dehors, sans grottes, sans fenêtres et sans toit – eux connaissent pour de bon le froid de la crevasse.
Tu songes aux tombes à nouveau recouvertes.
Tu rouvres les yeux et tu vois (c’est encore assez flou), les longs doigts d’une main qui écarte la neige comme tu le feras bientôt sur le pare-brise de la voiture ; la ligne sombre de montagnes miniatures ; la cendre des vieux rêves laissée par le volcan ; les ripples-marks d’un océan disparu ; les veines de ce grand estomac qui, Jonas, t’a happé et insidieusement te digère ; et puis, si tu t’approches, ces cristaux qui sont aussi étoiles, atomes de ton corps, agrégats du vieux moi illusoire, secondes par millions de nos poudreux parcours ; ou bien, si tu t’éloignes (mais toujours sans bouger), cette figure anthropomorphe, version neigeuse et démesurée du Cri de Munch, qui pose sur sa tempe et jusqu’au coin de l’œil exorbité ses longs doigts de fantôme et qui te dévisage…
Le soleil dissipe les visions.
Tu constates qu’à mieux y regarder (c’est maintenant possible), la couche est assez mince et le bleu pas si loin (cette manie, cette prétention que tu as de te dire enseveli sitôt qu’il neige un peu…). Finalement, cette première neige plus tardive, plus légère que d’ordinaire, ne fera peut-être qu’enluminer la grisaille de novembre (et puis, tu n’auras pas à pelleter trop longtemps). Tu te surprends à t’en réjouir, et tu murmures avec un soulagement puéril cette phrase relue dans la nuit : « 0n est encore pour un temps dans le cocon de la lumière… » [1], « tu es encore pour un temps dans le cocon de la lumière… », « je suis encore pour un temps dans le cocon de la lumière… »
Tu répètes cette phrase en changeant le pronom. Tu joues ?
« Il faut que nous soyons restés bien naïfs / pour nous croire sauvés par le bleu du ciel / ou châtiés par l’orage et la nuit. » [1]
Oui, il se pourrait qu’il faille être resté bien naïf pour vouloir à toute force lire dans tel petit cercle lumineux tracé à la fenêtre, tel obscurcissement du ciel, telle averse de neige d’ailleurs si prévisible, un signe qui nous concerne, un œil qui nous regarde… Et ce regard qu’on jette quand même vers la lueur qui grandit, qui ternit, qui semble soudain reprise par la nuit, est-ce qu’il n’est pas encore et toujours celui du vieil homme malade de métaphysique, de ce mendiant quêteur de sens qu’on prétend ne plus être ?
Fantasmes.
Projections anthropomorphiques primaires.
Verbeux radotage de celui qu’agite encore cette sorte de rêve toujours dénoncée et toujours rappelée qui ne cesse de hanter la poésie de Philippe Jaccottet – rêve à travers les déchirures duquel le monde, chez Jaccottet, apparaît néanmoins avec cette clarté froide qu’on voit en hiver sur les versants ensoleillés lorsqu’on est soi-même plongé dans l’ombre… On peut le voir ainsi.
Il me semble cependant que c’est là une analyse faussée, incomplète, d’ailleurs faite après coup. Sur le moment ce n’est pas le rêve d’un au-delà lumineux ni la crainte de l’obscur qui traverse la pénombre de mon intérieur enneigé. Cette « lueur de grotte » qui d’abord m’a frappé me ramène à une sensation première en laquelle les contours de mon humanité (et cela certes ne va pas sans inquiétude) se font naturellement plus poreux et plus flous.
Quelque chose de vrai est donné.
On ne projette pas. On reçoit.
On tourne toujours autour de cela.
Alexandre Chollier (citant Édouard Glissant) ici me murmure qu’anthropomorphisme et géomorphisme « correspondent peut-être de manière profonde à quelque dimension bien plus perceptible, qui est que l’espèce humaine a tendance à rendre équivalents et solidaires les balancements de son être et les mouvements du monde ». [2] L’homme qui regarde à la fenêtre et qui, étrangement, se sent lui-même regardé, se situe dorénavant « dans un horizon à la fois plus unitaire et plus englobant » qui le décentre de lui-même.
« Cosmomorphisme » plutôt qu’anthropomorphisme.
« À l’horizon du cosmomorphisme l’homme ne se connaît pas. Il ignore s’il est lui. C’est le monde qui le révèle à lui-même. Ici une personne pose ses repères et prend conscience de la mesure du monde ».
Ici une personne pose ses repères et prend conscience de la mesure du monde…
Vu depuis la vallée, Belledonne est une forteresse blanche aux murailles de neige — et moi, le tout petit point opaque, brillant, tremblotant, pas du tout immobile, d’un flocon sur la vitre.
Illusion, l’arrêt du mouvement, l’occultation du monde.
Réalité, la lumière qui passe au travers de la vitre et ces flocons qui glissent, se déforment, se recomposent et délivrent d’heure en heure, de jour en jour, des messages toujours changeants qui suggèrent un possible mais tortueux chemin…
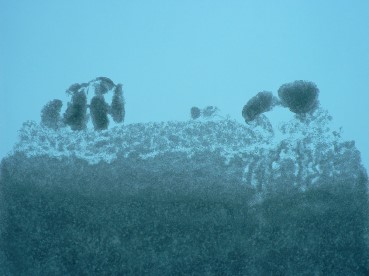
22 novembre 2014
___________________________
[1] Philippe Jaccottet, Pensées sous les nuages, Gallimard, 1983.
[2] Alexandre Chollier, Autour du cairn, Héros-Limite, 2009.

