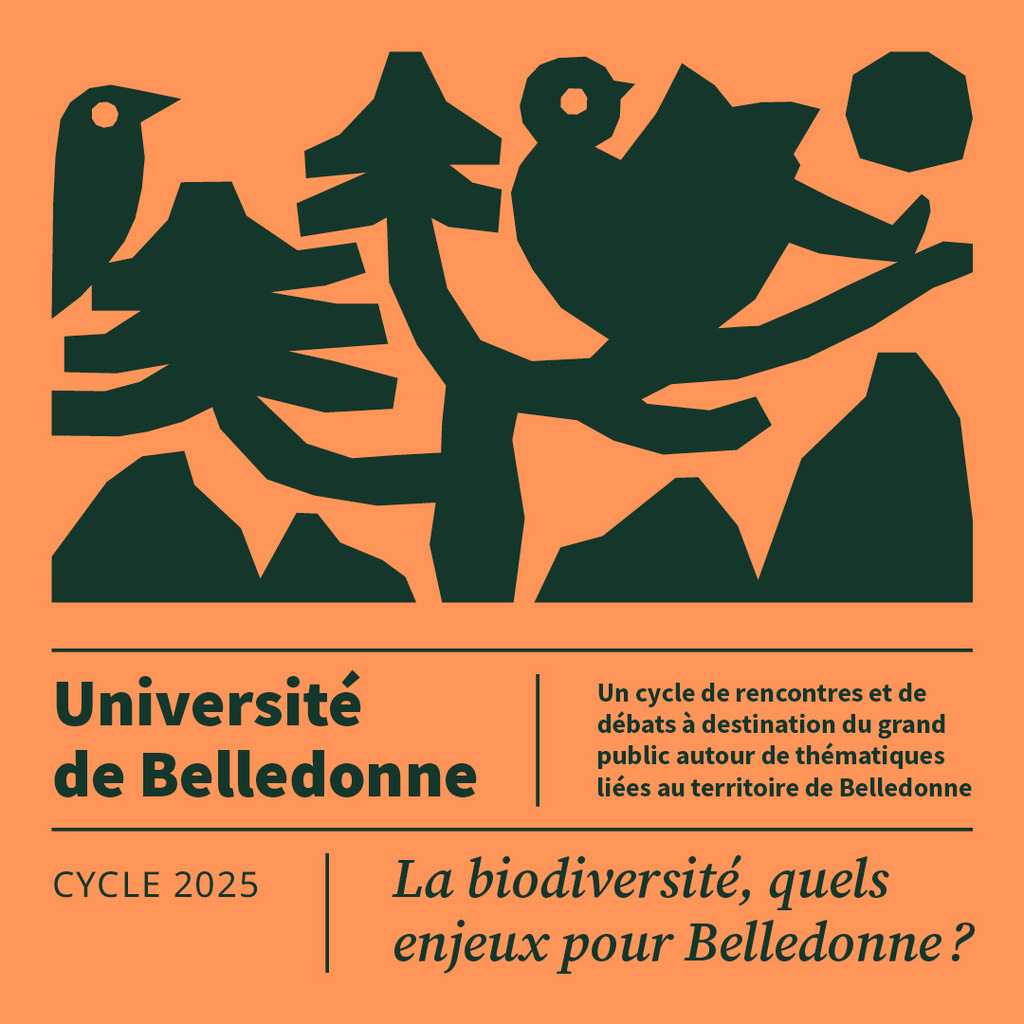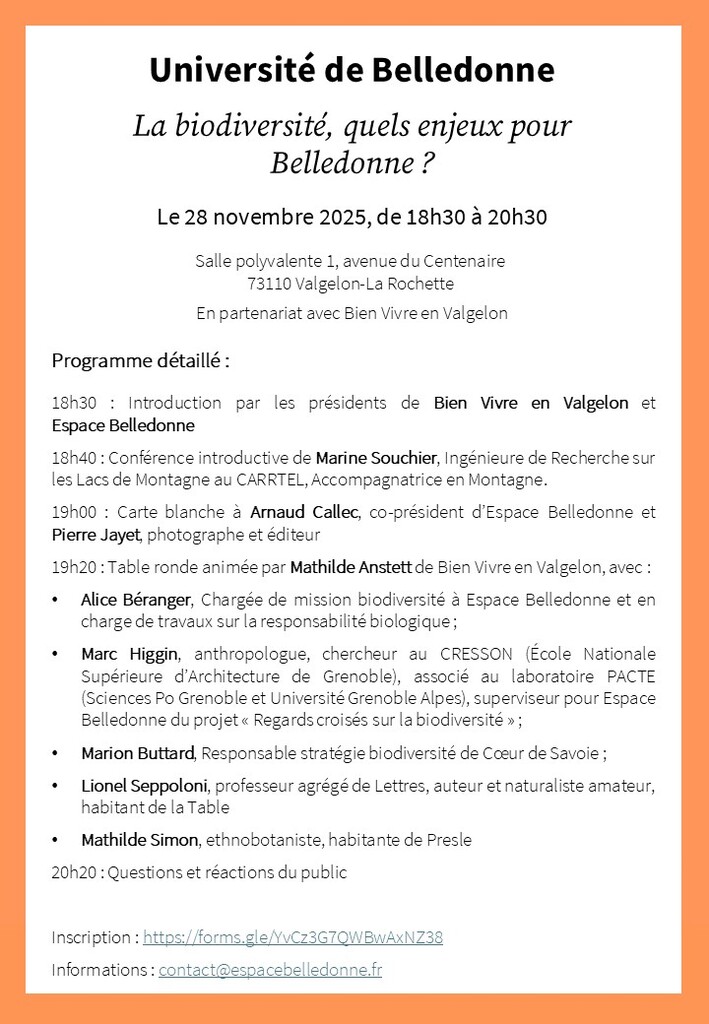TOMBEAU DES AMPHIBIENS

L’averse d’avril fouette le goudron, blanchit l’eau de la gouille et précipite sur la chaussée grenouilles affolées et fleurs de prunier. Un triton alpestre gît sur une pierre, son ventre orange tourné vers le ciel. Une pie becquette les viscères de quelque grenouille fraîchement aplatie dont on peine à distinguer la forme, tant elle se confond avec le revêtement de la route (ce pourrait être une stratégie de camouflage qui aurait mal tourné…). Roulant au ralenti, je contourne une grenouille rousse encore bien vivante qui, d’un bon bien élastique, atteint finalement la rive de la forêt.
*
J’aime les Amphibiens d’abord pour la fragilité que leur confère cette peau fine, perméable, soyeuse plutôt que visqueuse, qui m’évoque celle d’une très vieille personne, d’un nouveau-né, ou de ces chats sans poils qu’on appelle des sphynx. Ce sont des êtres à nu, sans défense face aux agressions de l’époque. Quand un crapaud rencontre un prédateur, il entre en catalepsie, il fait le mort − stratégie évidemment désastreuse face aux voitures.
J’aime les Amphibiens parce qu’ils se jouent des frontières. Nomades sédentaires, la plupart d’entre eux passent la première partie de leur vie dans l’eau, la quittent après leur métamorphose et la perte de leurs branchies, puis y reviennent au prix parfois de migrations discrètement spectaculaires. L’énergie avec laquelle les grenouilles rousses traversent les champs encore enneigés pour rejoindre la mare de mon village (qui est, dit-on, l’une des plus importantes frayères de basse altitude de Savoie), force l’admiration.
J’aime tous les Amphibiens, sans exception, parce que je les trouve fragiles et beaux, et parce que j’ai passé bien des heures, lorsque j’étais enfant, à les observer. Je crois que je pourrais sans peine parcourir toute ma vie à l’envers en allant d’un souvenir d’Amphibien à l’autre.
Viennent aussitôt en tête ces deux images anciennes, précieuses et souvent évoquées : la rainette verte trouvée dans le parc de Ferney, à une période où les rainettes ont déjà presque disparu (je n’en ai de fait jamais revu) ; et cette famille de salamandres débusquée dans ce même parc.
Plus tard, assis sur le rebord de l’ancien lavoir du Carrel dans l’avant-pays savoyard, je regarde interminablement les tritons monter à la surface pour aspirer leur bulle d’air, puis se laisser retomber lentement, comme grisés. Si je tends l’oreille j’entends encore le chant cristallin, assez semblable à celui du hibou petit-duc, du minuscule crapaud alyte (Alytes obstetricans); c’est un soir de juin, le mâle porte les têtards sur son dos (d’où son surnom de « crapaud accoucheur ») et je reste à quatre pattes près de la butte sablonneuse où ils nichent pour observer ce prodige à la lueur des lampes. Pendant ce temps, comme chaque soir, le gros crapaud commun Bufo bufo prend son bain dans la gamelle d’eau des chats – et cette nouvelle image fait ruisseler tout un passé spongieux en lequel je replonge.
Voici que chantent à nouveau les cent-mille batraciens qui hantent les sansouires de Camargue, voici que défilent sur le parebrise de ma mémoire la cohorte bruyante et bariolée des rainettes vertes, des dendrobates bleues, des crapauds buffles au cri rauque et puissant, des grenouilles feuilles, barrées, croisées, jaunes, roses, orange ou turquoise, avec qui j’ai partagé des années durant quelques carbets en forêt guyanaise, moult suintantes équipées ainsi que trois maisons qui étaient leurs plus que miennes, puisque je les ai toutes quittées alors qu’elles y sont, je suppose, restées…
Aujourd’hui ces Amphibiens apparus il y a plus de quatre cents millions d’années (contre sept millions à peine pour les premiers hominidés), constituent « le groupe vivant le plus menacé sur notre planète, et de loin » : « pas une espèce (lisais-je hier dans Le Monde), ni même une famille ou un ordre, mais bien une classe dans son ensemble ». En France métropolitaine, c’est une espèce sur cinq qui risque à brève échéance une totale extinction, à cause de la pollution des eaux, des sols et de l’atmosphère, de la destruction des zones humides, du braconnage et de la mortalité sur les routes. Cet émerveillement que manifestent maintenant mes fils devant le retour printanier des grenouilles, leurs propres enfants ne le connaitront sans doute pas. Il y a pire, je sais bien ; mais c’est aussi un signe manifeste et préoccupant du pire qui se prépare : ce « printemps silencieux » du livre de Rachel Carson, ce monde devenu inhabitable et inhumain, puisque livré à la folie destructrice du seul humain.
*
En attendant, je roule fenêtre entrouverte en écoutant la pluie et, sur France Musique, le violon de Yehudi Menuhin.
Je ne pensais pas parler des grenouilles, mais du violon de Menuhin. J’avais commencé à improviser une sorte de poème, qui disait :
Le violon de Menuhin
fait pleurer la pluie
à l’intérieur de l’habitable
avec quelle douceur
quelle tendresse
retenue.
On s’abandonne sans drame
à tout ce qui persiste
et la vie sous toutes ses formes
semble riche et belle
ainsi nimbée de printemps
et portée par le chant paisible
du violon de Menuhin…
Puissent ces fleurs, ces lignes, et le violon de Menuhin, offrir aux Amphibiens de mon enfance et à tous ceux morts sur ma route, un tombeau digne d’eux.
6 avril 2016