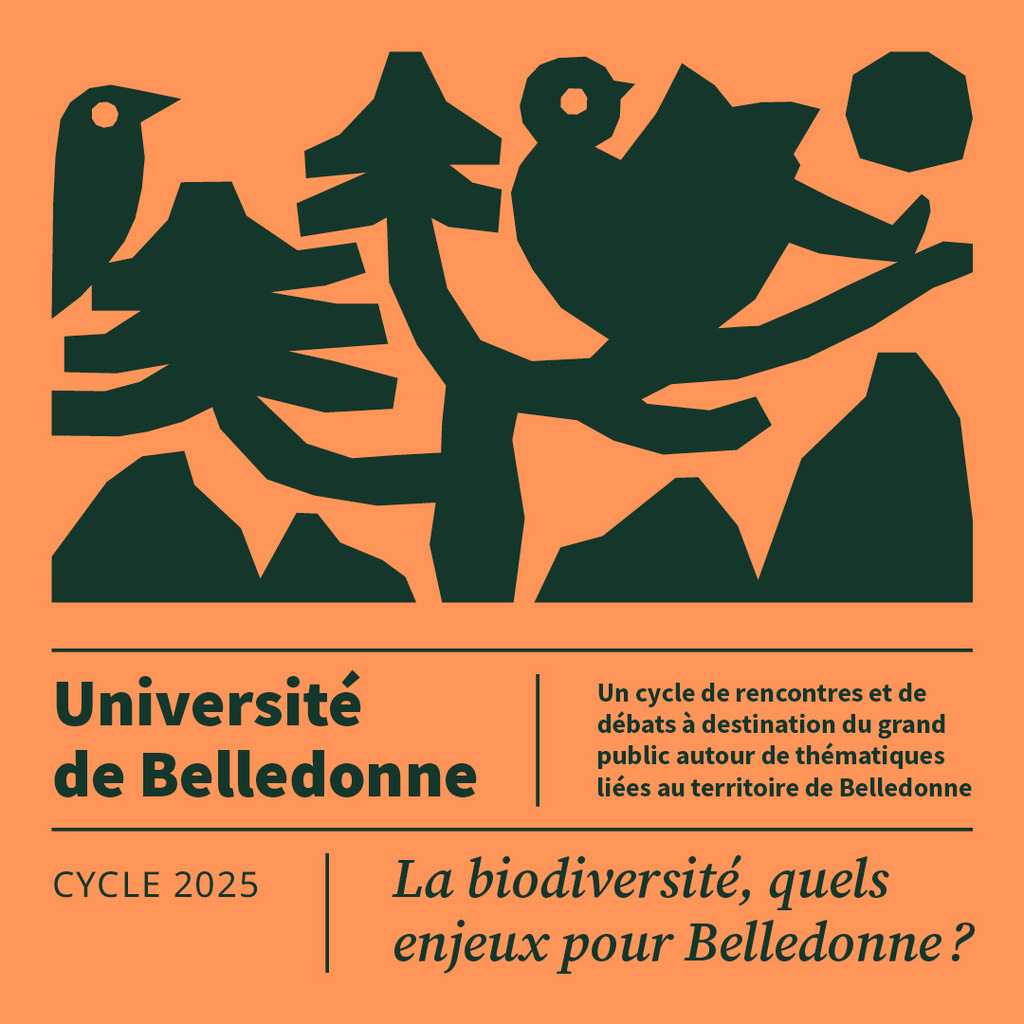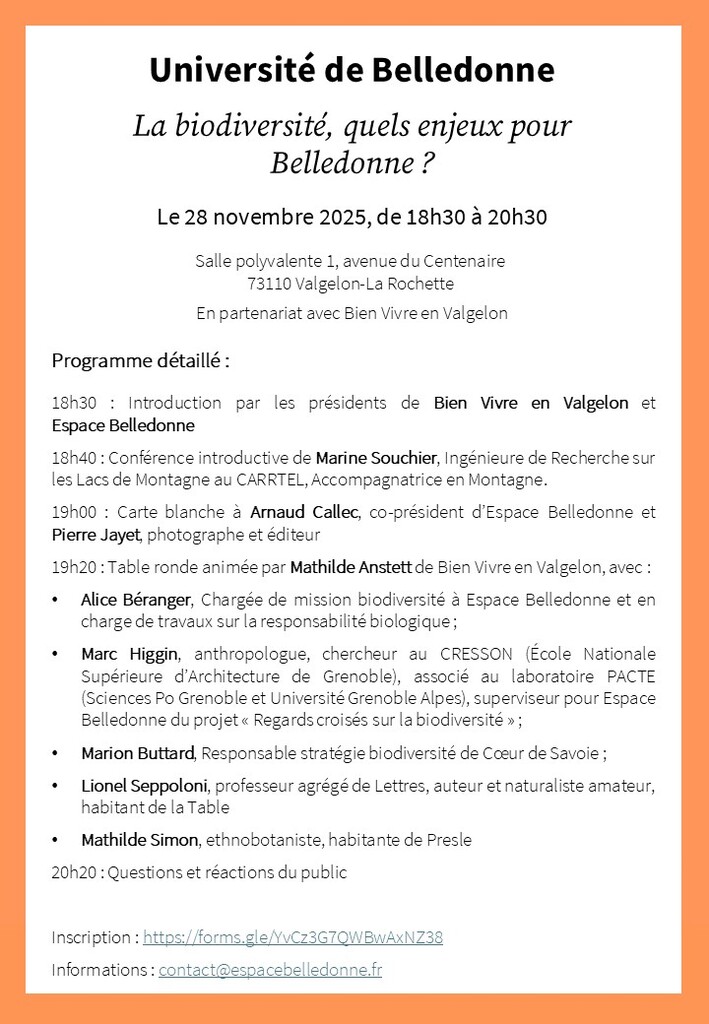SOLO
(l’écriture, le dedans, le dehors, les « maîtres »)
Temps toujours frisquet, petite gelée de mai. Un bouvreuil pivoine se pose sur l’étendoir à linge, tache rouge bien visible dans le vert qui disparaît aussitôt. Mon enfant me demande pourquoi les oiseaux disparaissent, pourquoi les hommes détruisent la nature. Longue dissertation.
En sortant de la maison un brin d’herbe m’arrête. Il y a quelque chose d’inhabituel qui m’a regardé, dont je viens en tout cas de croiser le regard. Le mot qui me vient en tête est celui de grenouille. Je cherche. Quelqu’un a planté devant la maison une sorte de petit bâton avec deux ressorts enroulés qui dessinent comme une paire de lunettes. Je me penche : il s’agit d’une tige de pissenlit qui s’est ouverte en deux à son extrémité supérieure, puis repliée de part et d’autre en deux tourbillons parfaitement réguliers qui donnent en effet l’impression d’une paire de lunettes avec des yeux. Je reste un moment à considérer cette forme inattendue qui me permet en passant de voir différemment les herbes alentour, les pissenlits, toutes ces formes d’une vie végétale si différente de la mienne et qui s’épanouit au pied de la maison.
Regarder, toucher du doigt la différence des mondes et tenter de le dire, ce n’est pas se métamorphoser. Cela ne mène à aucune libération, solution, dissolution, ni quoi que ce soit du même ordre. Tout au plus peut-on parler d’une brève stupéfaction, d’un instant où l’illusion du sujet observant est entrevue en tant que telle. Je crois avoir connu au moins une fois ou deux des processus de dissolution assez poussés (ce fut, une fois, tout à fait vertigineux et presque effrayant). Je ne nie pas la possibilité qu’il existe de par le monde des êtres véritablement « éveillés » qui, ayant traversé jusqu’au bout de tels processus, évoluent désormais dans un espace mental très épuré. Atteindre un tel dégagement est sans doute la condition pour pouvoir prétendre à une parole elle-même dégagée, comme dans les plus beaux haïkus de Bashô peut-être. Mais la plupart du temps, même dans les haïkus, les sensations de monde sont toujours reliées à des sentiments (sans nécessairement que la sentimentalité s’en mêle).
C’est peut-être une simple forme de pudeur, ou de distance entretenue et mêlée à une vraie curiosité pour le monde, qui a conduit des écrivains comme Réda, Abraham, Bouvier à consacrer la plus grande partie de leur œuvre à des descriptions ou à des évocations du monde extérieur. (Face à quelqu’un qui s’étonnait de ce que ses écrits n’évoquaient pas son intimité ni même les sentiments éprouvés par l’auteur, Réda, avec un rien de roublardise, fait mine de s’étonner : « Ah bon ? Mais j’ai l’impression de n’avoir fait que cela ! »)
Je m’intéresse en tout cas à ce passage, à ce va-et-vient entre dehors et dedans, intérieur et extérieur, intimité et extimité (si j’ose dire), avec parfois quelques poussées aux limites. Dans le contexte de destruction généralisé de la nature que nous connaissons, dans ce contexte très particulier où le monde n’est véritablement plus considéré, à l’échelle de notre espèce, que comme matière morte à exploiter, à transformer, à aménager, rétablir pour soi-même un certain nombre de connexions me semble la priorité, ce en tout cas par quoi il faut commencer et ce que j’essaie de faire au quotidien, par le biais de la parole. Cela ne fonde rien de bien neuf, cela ne prétend pas étudier le fonctionnement de l’univers ; tout au plus à prêter attention au battement du volet qui tantôt ouvre, tantôt referme la fenêtre de notre attention.
L’écriture vise ainsi bel et bien autre chose que l’écriture. Pour les tenants d’une certaine perfection littéraire, les quelques textes, les quelques poèmes parfois que j’ai pu tenter seront jugés bien inégaux ; inégale est aussi l’expérience de leur auteur, avec ses hauts et ses bas, ses moments vifs et ses moments morts. Pour les tenants de l’exploration intime, ces considérations concernant la montagne, les oiseaux, toutes ces choses vues et notées laborieusement n’auront probablement aucun sens et aucun intérêt. Pour les tenants, plus rares, de la pure extériorité, ce sera tout aussi peu satisfaisant — insignifiant. Ma marge de manœuvre est maigre, mon espace restreint.
Me voici donc plus ou moins contraint de créer mon propre espace. À tout prendre j’aurais préféré, et de beaucoup, m’inscrire durablement dans un espace pré-existant. Faisant violence à un tempérament particulièrement solitaire et rétif à tout rassemblement, je me suis parfois greffé au sein de groupes de telle ou telle nature. Je me suis cherché, j’ai trouvé, des maîtres. Je ne le regrette pas. Il est de bon ton de critiquer avec condescendance ce type de recherche. Il y a de bonnes raisons à ces critiques, d’ailleurs. Le besoin de se rassurer et de se fabriquer une couche identitaire supplémentaire guide souvent ceux qui ainsi se rassemblent. J’ai cependant joué le jeu avec conviction. À chaque fois ce fut une expérience intense. À chaque fois aussi, au bout d’un certain temps, je me sentais corseté, à l’étroit, et parlant un langage qu’on ne comprenait pas, ou qui finissait par sembler plus ou moins inadéquat. Cette question du langage est tout à fait importante : dans chacun de ces groupes et dans tout groupe en fait, parti, syndicat, congrégation religieuse, association, le néophyte se rend rapidement compte qu’il y a des mots autorisés et d’autres prohibés. C’est à chaque fois une façon de corseter l’expérience, de refermer l’espace ouvert.
Je suis donc passé par divers groupes, disais-je : parti politique (mais j’étais si jeune, encore enfant, et il y a prescription) ; syndicat (la rupture fut rapide et brutale); université lors de mes études de lettres (ce fut de longues fiançailles sans mariage) ; quelques groupes d’ornithologues et de naturalistes (mais la dimension artistique, le travail et la réflexion sur l’expression me manquaient) ; deux ou trois écoles bouddhistes ; l’institut international de géopoétique (plus tard, mais je ne le sais pas encore, je ferai même parti d’un orchestre d’accordéons, et ce sera peut-être la plus épanouissante expérience de groupe que je connaîtrai…).
Je n’ai, dans l’ensemble, pas de reproches cinglants à adresser aux uns et aux autres. Chacune de ces institutions a son utilité, sa raison d’être, et m’a apporté quelque chose de précieux. Aucune ne m’offrait véritablement l’espace dans lequel j’aurais pu me sentir tout à fait à mon aise. La géopoétique était celui en lequel se retrouvait le plus grand nombre des préoccupations qui me guident — mais ce qu’il y a en moi de distance, de doutes et de fragilité ainsi qu’un attachement indéfectible pour le travail purement littéraire, ne s’y retrouvait pas. Passons.
Tout cela m’a finalement conduit à revenir à un travail solitaire, de toute façon indispensable (à l’exception du syndicat, tous ces mouvements que j’ai pu côtoyer ont toujours insisté avec force sur le caractère profondément solitaire du parcours).
Je chanterai donc en solo avec le vent de mai…
jeudi 15 mai 2014