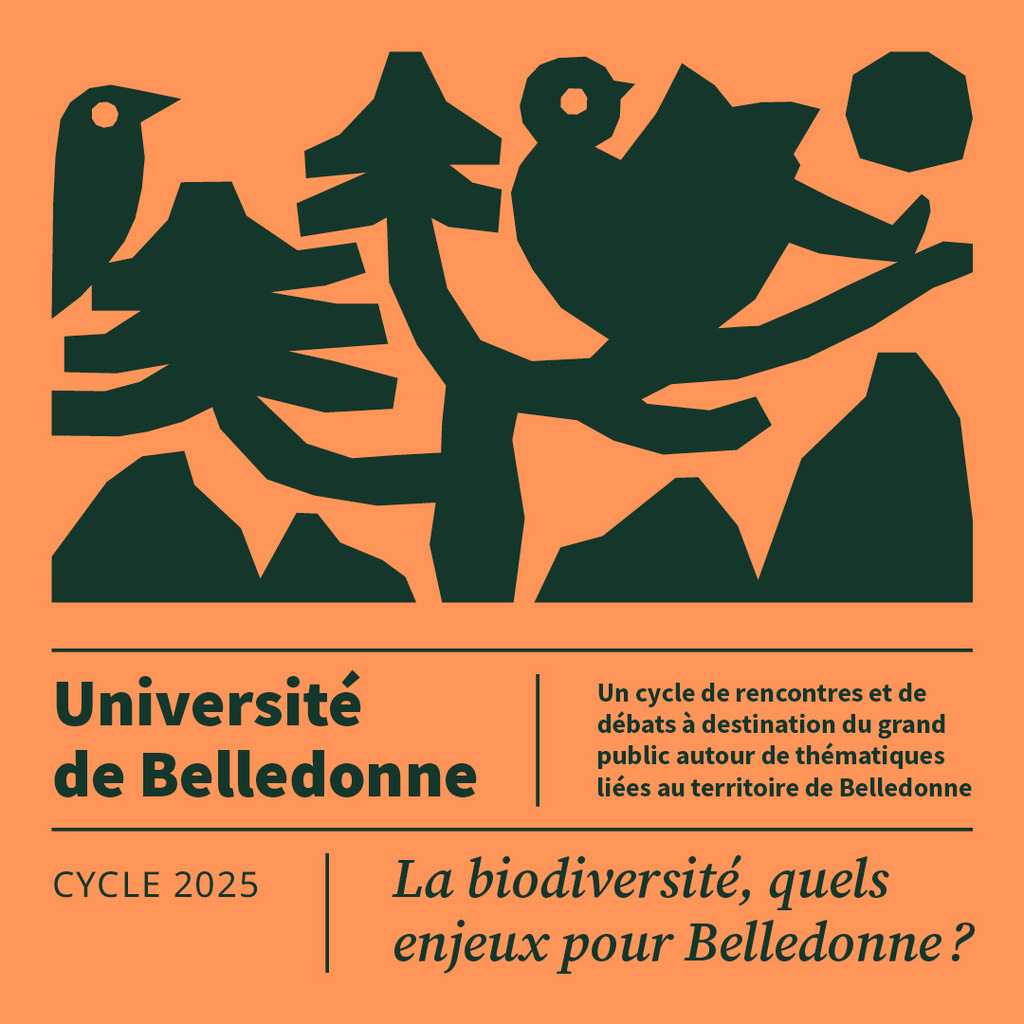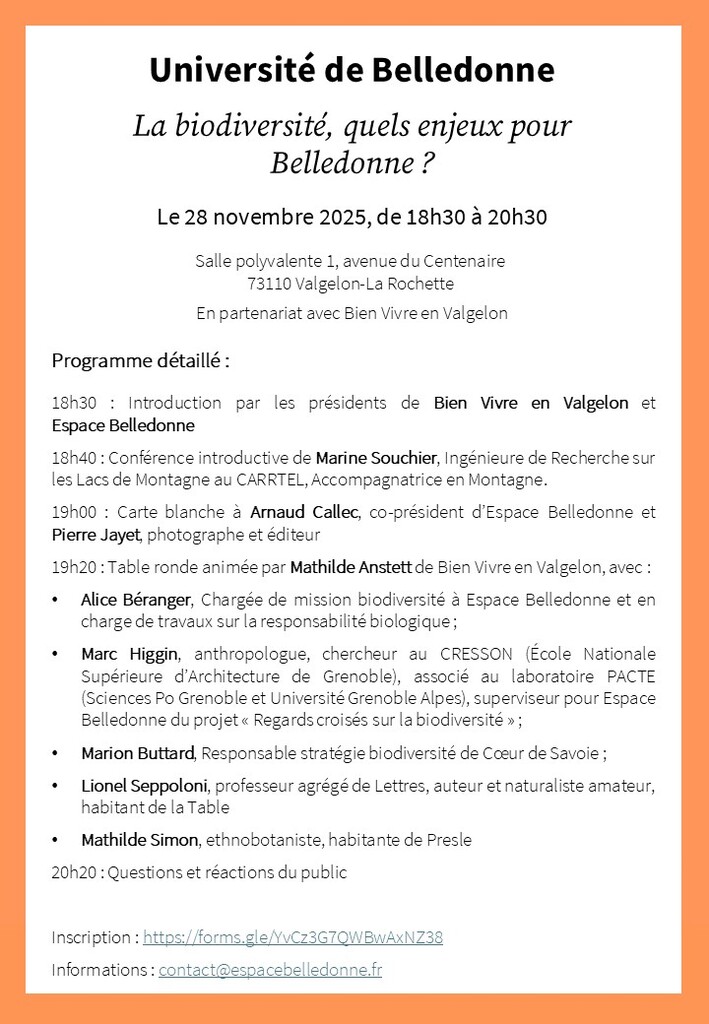1.
De Cayenne à Cuiaba.
Vendredi 7 avril.
16h30, le tout petit avion à hélices d’Air Guyane affrété par la compagnie brésilienne TAF survole la forêt, les nuages. Les oreilles bouchées par le vacarme des moteurs, on regarde avec perplexité le ciel noir à l’horizon bouché. « Nous n’irons pas plus loin te dit le capitaine / Trop d’obstacles aujourd’hui pour gagner l’horizon… » : les paroles de cette chanson que l’on écoutait avant de partir, nous les aurons bien souvent en tête.
D’après ce qu’annonce le commandant de bord (dont on peut suivre tous les gestes, juste là devant nous, dans la cabine encombrée de manettes, de cadrans et de leviers d’une complexité inquiétante), il faudra deux heures au moins pour faire les 600 kilomètres qui nous séparent de Macapá, soit le double du délai habituel. Deux heures, « si dieu veut ». Les passagers brésiliens s’esclaffent quand on demande si ce fumeux coucou assure les mêmes arrêts que le bus Oiapoque / Macapá… Ce bus, qu’on imagine quelque part en dessous de nous embourbé jusqu’aux vitres ou braqué par des gangsters armés de kalachnikov, nous n’avons pas voulu le prendre cette fois-ci, tant l’état de la piste en saison des pluies et les risques d’attaques rendaient le voyage vraiment hasardeux (n’en déplaise à Lie-tseu, le véritable but du voyageur est parfois d’arriver là où il va). Nous avons donc choisi la TAF pour gagner la capitale de l’Amapa, puis Brasilia par un avion de nuit de la GOL, et enfin Cuiabá dans le Mato Grosso, aux portes du Pantanal. Nous n’aurions jamais dû nous retrouver dans ce petit appareil (probablement le même que celui que nous avions pris il y a six ans pour rejoindre Maripasoula) ; mais le départ a été assez chaotique.
Hier après-midi, un appel téléphonique de la TAF nous informe que le vol est reporté, déplacé, compromis. On craint ou on espère (c’est selon) qu’il soit définitivement impossible de prendre notre correspondance pour Cuiabá. J’accepte pour ma part aussitôt l’idée de perdre l’argent des billets d’avion : nous resterons tranquillement dans notre belle maison de Rémire à regarder tomber la pluie sur les grasses branches du manguier, en compagnie des chats, de la chienne et des agoutis, et la perspective de ces deux semaines de quiétude domestique m’enchante. Si le voyage ne se fait pas, c’est qu’il ne devait pas se faire ; l’avion se serait écrasé, un caïman nous aurait mangés, la nourriture empoisonnés ; et puis, Nathalie, enceinte, sera de toute façon mieux à la maison. Il semble d’ailleurs que les avions de la TAF ne soient pas très fiables : ces problèmes de dernière minute seraient dus à une interdiction de se poser sur le territoire guyanais, des travaux de mise aux normes demandés de longue date n’ayant pas été effectués…
Pourtant, ce matin, après encore quelques coups de fil, le départ a été contre toute attente maintenu pour 16 heures. Nos amis Delphine et Sébastien, que j’ai appelés à l’école de Saint-Georges de l’Oyapock, ont dû sauter dans leur 4×4, parcourir en un temps record les 250 kilomètres de mauvaise route qui les séparent de Cayenne, pour arriver à l’heure à l’aéroport. Pendant que la plupart des passagers attendaient un hypothétique grand courrier, annoncé donc pour 16 heures, les quelques passagers ayant une correspondance de nuit à Macapa ont été autorisés à prendre en catimini ce petit appareil d’Air Guyane.
C’est donc maintenant le grand calme ennuyeux des voyages en avion – si tant est que l’on puisse parler de calme, car le boucan que fait ce tacot est proprement infernal. Bientôt, ce sera la longue attente nocturne dans le hall de l’aéroport de Macapá, puis le départ pour le Mato Grosso, Cuiaba via Brasilia. Si dieu veut…
Le stylo noir se met soudain à pleurer de l’encre, ce qui ne lui était jamais arrivé. L’altitude ? Ou bien un nouveau présage ? Tout cela n’augure rien de bon, et ce voyage ne commence pas bien du tout. L’argent, aussi, risque de manquer dans ce Brésil alors en plein essor économique et devenu, avec l’augmentation du real, trop cher pour notre budget. Plus préoccupant, la grossesse de Nathalie aurait peut-être dû nous inciter à rester au port (mais gynécologue et docteurs ont été formels et unanimes : le voyage n’est en rien déconseillé, elle peut même « faire du trampoline »).
Trêve de superstition, de faux suspense et d’inquiétudes feintes : le ciel se dégage, les passagers s’assoupissent dans leurs sièges trop serrés, l’avion même ne bouge pas. Moi, je pense à ce tout petit clandestin qui voyage aussi sur le siège d’à côté, et l’appréhension du départ se dissipe. On verra bien comment se remplissent ces pages…
Plus tard, arrivée sur Macapá.
Des plis vert tendre
à perte de vue
la forêt rasée.
On descend lentement sur Macapá après un parcours bien tranquille. Vu de la route, ce paysage de forêt détruite a quelque chose de navrant ; mais vu du ciel, ce vert pastel parsemé de marais et de criques, semble d’une grande douceur printanière, et l’on se laisse aller à de trompeuses images d’avrils printaniers. Le soleil couchant allonge démesurément les silhouettes, les hublots sont noyés de lumière dorée. On vire de l’aile, et voici sur notre gauche le fleuve Amazone et les rues rectilignes de la capitale de l’Amapá. Maisons dorées, barge immobile dorée dans les eaux dorées du grand fleuve, puis des champs cultivés bien découpés et, partout, des baraques dont on ne saurait soupçonner la misère : Macapá vu d’en haut.
22h45. On mange, mal, derrière les baies vitrées de la Casa do Pão de Queijo : décor beigeasse, climatiseur rouillé, quelques tables en verre, de rares clients, et d’insipides sandwiches mous au salami & ketchup. Le temps passe ensuite à deviser en baillant, assis sur les vieux fauteuils marron gris du hall de l’aéroport. Néons clignotants, ventilateurs poussifs, quelques éclopés qui passent : l’aéroport, ouvert directement sur la ville, évoque plutôt quelque sinistre hall de gare tropical d’une province que même les trains auraient oublié. Sur les autres sièges, quelques passagers attendent, plus ou moins affalés. Un Brésilien discute vivement avec son téléphone portable, laissant filer dans l’air tiède où zigzaguent les moustiques les bribes de cet accent chantant et nonchalent qui est un régal pour les oreilles.
Il n’est pas désagréable de n’avoir rien d’autre à faire que regarder les gens passer, assis dans ce fauteuil miteux sur fond de crépi orange écaillé. À la grande horloge jaune marquée « religiosos publicitarios » (que je dessine sur le carnet), il est maintenant vingt-trois heures. Un petit monsieur lunetté aux cheveux impeccablement blancs discute avec force gestes, debout devant un compère assis – celui-là plus négligé, débardeur orange en short de jean – sur l’un des fauteuils. Les Italiens ne sont pas les seuls à parler avec leurs mains : on ne sait s’il explique à l’autre son travail d’agent de la circulation dans le centre ville, le fonctionnement d’une machine à vapeur ou bien ses derniers exploits à la pêche, mais il y met une conviction extraordinaire.
Les paupières brûlent un peu. À mesure que la nuit s’avance, le hall commence à se peupler. C’est probablement ainsi chaque nuit. Certains visages sont très beaux, aucun n’est marqué par la fatigue, la lassitude, l’énervement, ni tout ce qui se lit habituellement sur les visages des gens dans n’importe quelle gare. Un quidam désœuvré autant que moi se plante devant une photo d’ibis rouge et la contemple longuement, scrupuleusement, bouche ouverte et ventre en avant. Une conversation s’engage entre lui et le responsable du kiosque « Brazil Amapa » devant lequel je suis installé, et sur lequel sont accrochés quelques clichés palots des merveilles de la région. Ne comprenant quasiment rien, je n’en savoure que davantage la beauté sensuelle et musicale du brésilien.
Et c’est ainsi que le temps passe, et que les mots tracés ou prononcés aident à garder les yeux ouverts…
1 heure du matin. Les bagages enregistrés jusqu’à Cuiabá, nous attendons maintenant dans une nouvelle salle l’avion pour Brasilia. Vaste salle bondée de gens au regard agrandi par la fatigue, vacarme du téléviseur qui diffuse un dessin animé aux couleurs criardes, murs écaillés, immenses climatiseurs fixés de travers. On voit de plus en plus flou : est-ce à cause de l’image brouillée du téléviseur, du manque de sommeil ou de l’éloignement du voyage ?
Samedi 8 avril.
Brasilia, 7h30. On arrive, un peu hagard, sur la capitale administrative baignée de brume. Quelques images d’avenues, de maisons avec piscine, de collines maigrelettes, puis c’est le petit aéroport moderne par où transitent les vols intérieurs (les vols internationaux passent quant à eux par Rio et Sao Paulo). Ici, plus de Noirs ni d’Indiens : le type dominant est résolument portugais, européen, l’habillement chic et austère. Il fait frais, 18° seulement. Les grandes baies vitrées laissent entrevoir un paysage plat, de petits arbres en fleurs, quelques manguiers malingres.
9h40, encore un avion, et le départ pour Cuiaba est imminent : près de deux heures de vol encore, avec un décalage horaire d’une heure. Alignement des avions de la Tam (« fière d’être brésilienne », précisent les slogans peints sur les carlingues), ton chantant du brésilien, ciel gris.
Cuiabá, Mato Grosso Palace Hotel, 18h30.
Le climatiseur ronfle, il fait maintenant nuit, et j’émerge d’un sommeil profond, la tête encore bourdonnante de moteurs d’avion.
Lorsque l’avion a commencé à descendre sur les plaines et les montagnes du Mato Grosso, j’espérais que nous puissions dès l’après-midi partir en reconnaissance le long d’une de ces pistes rouges qui striaient des champs manifestement inondés, et peut-être même monter au sommet de l’un de ces mornes en haut desquels on devait pouvoir contempler tout le paysage et, j’imaginais, les vols de aras bleus ou hyacinthes, les toucans… Ce projet a cependant dû être différé.
À l’arrivée à l’aéroport de Cuiabá, nous nous sommes pourtant aussitôt décidés : nous louerions une voiture, avant de rejoindre l’hôtel que nous avions réservé et de partir au plus vite à l’aventure. Malheureusement, un individu nous aborde, qui se présente comme guide pour une agence, et qui nous déconseille fortement un tel projet. La Transpantanéira, la route que nous comptons prendre, est inondée, impraticable pour une petite voiture – mais pas pour son bus, avec lequel il nous emmènera volontiers. Ce qu’il dit est peut-être vrai, car la plaine paraissait en effet bien inondée, mais il nous faut d’autres renseignements plus fiables. Nous tentons de nous renseigner auprès des loueurs et de différentes personnes, mais cet individu nous devance, s’adresse à notre place aux Brésiliens et, nous coupant le renseignement sous le pied, souffle les réponses qui l’arrangent. Son comportement devient exaspérant, aussi finissons-nous par renoncer à louer notre voiture et nous rendons directement à l’hôtel, où il devrait être possible d’obtenir des renseignements. Nous aviserons ensuite.
La ville ressemble à Belém, en plus riche : toujours ces rues rectilignes, ces immeubles aux couleurs criardes, ces façades fatiguées… Tout semble fermé, car c’est jour férié pour la grande fête de Cuiabá. Arrivés à l’hôtel, où d’autres guides nous abordent avec courtoisie et sans insister, nous comprenons que notre gêneur a eu le culot de téléphoner pour annoncer notre arrivée : quatre Français qui, les malheureux, veulent louer une voiture au lieu d’emprunter son mini-bus ! Nous pouvons enfin nous laver, et nous renseigner en téléphonant à la poussada Rio Claro, au PK 49 de la Transpantanéira, que nous comptions rejoindre : d’après eux, la route est praticable.
Le temps de nous changer et d’observer un peu, à la fenêtre, ce paysage urbain qui est apparemment celui de tous les hôtels de toutes les grandes villes du Brésil (volée de moineaux domestiques au-dessus des terrasses grises), nous repartons manger dans un petit restaurant au kilo, puis retournons à l’aéroport louer la voiture dont nous avons besoin : une Volkswagen « Gol » trois portes en bon état. Nous faisons quelques courses dans un immense hangar où s’alignent des kilomètres de canettes de bière « Skôl » entassées jusqu’au plafond. Au détour d’une rue, voici un bus qui s’est littéralement encastré en se soulevant dans la façade d’un immeuble : on regarde, perplexe, l’invraisemblable accident, qui illustre assez bien les problèmes rencontrés par les Brésiliens désireux d’emprunter les transports en commun…
Retour à l’hôtel. Malgré son nom, ce n’est pas un « palace », mais un hôtel propre et totalement dépourvu de charme et de personnalité. On prépare l’excursion du lendemain au Parc National Chapada dos Guimaraes, une sorte de mise en bouche avant le grand repas pantanaléique : à soixante kilomètres de la ville, un paysage de grand canyon, sur un haut-plateau qui marque la frontière avec l’Amazonie. L’air y est plus frais (la température en ville cet après-midi était tout de même de 37°) et il y a, parait-il, une chute d’eau impressionnante…
Pour l’heure, les images de Cuiabá défilent dans la tête et sur le petit écran du téléviseur. On digèrera toute la nuit.