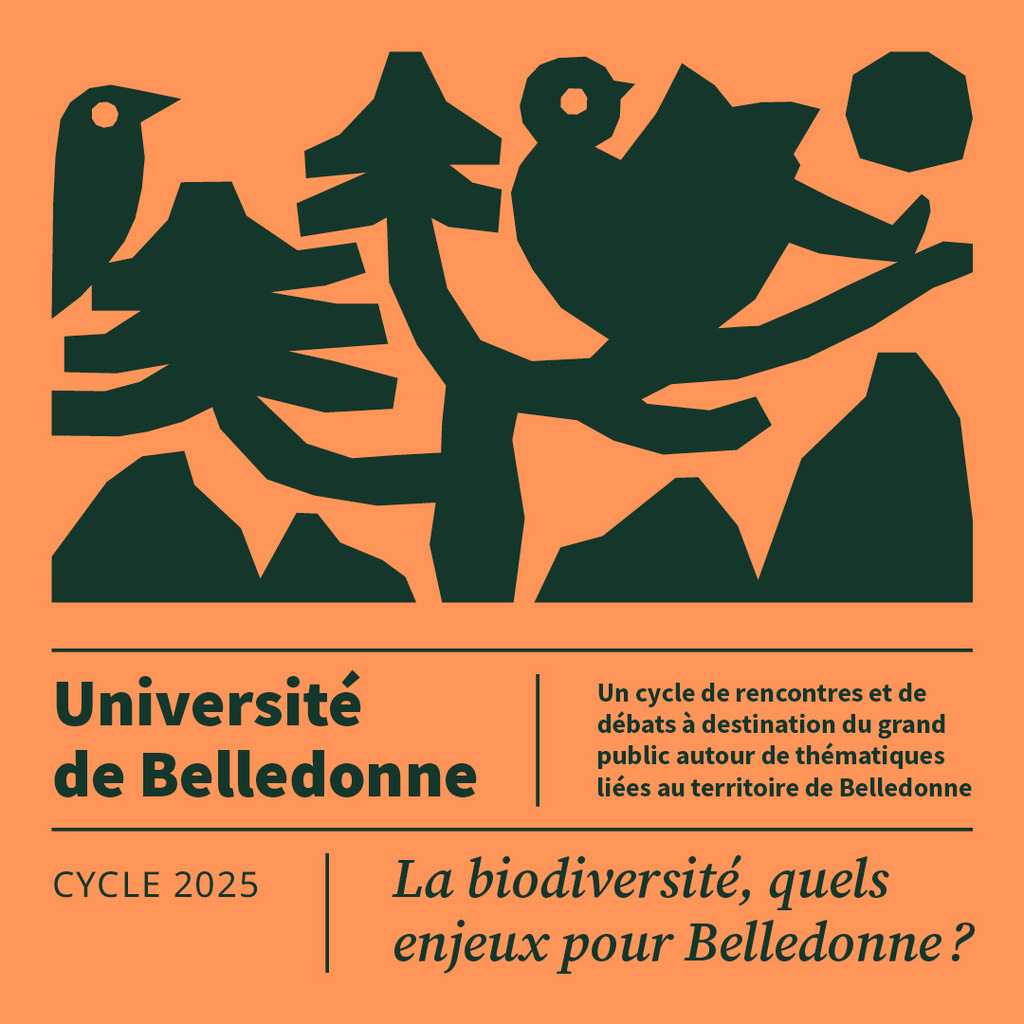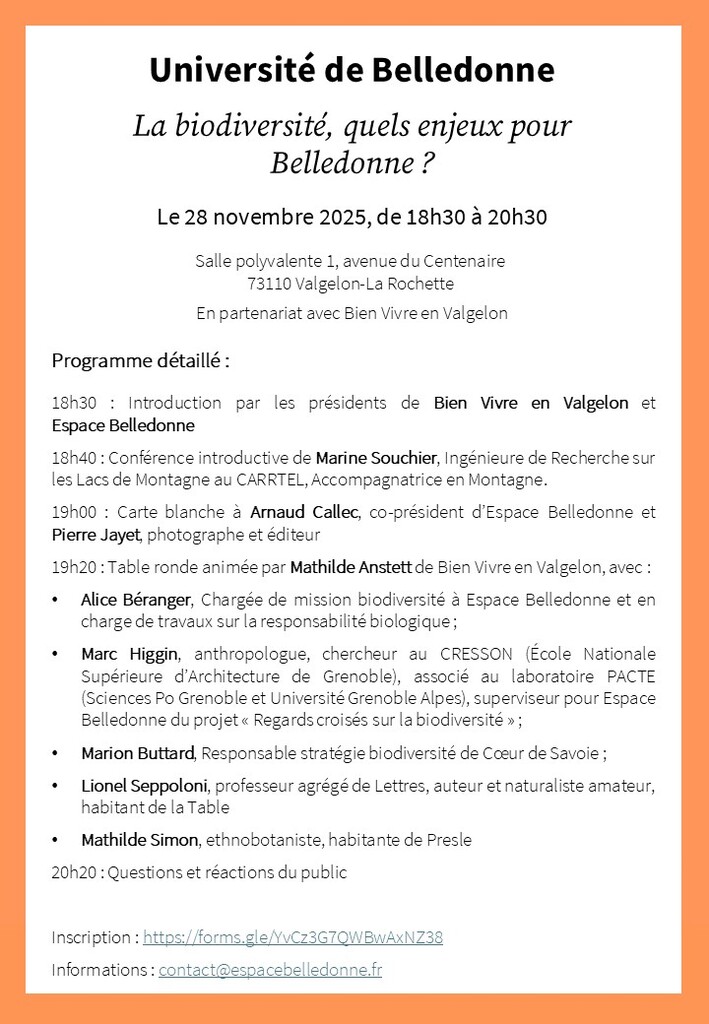Catherine, notre jeunesse est morte !

Souvent, et de façon bien cruelle, les dernières années ne sont qu’un effacement, et l’on dit de la vieille femme ou du vieillard qui peut-être a perdu sa mobilité, son visage, sa voix, ses repères, sa raison, qu’il n’est plus que l’ombre de lui-même. Cette ombre fait obstacle, elle finit par occulter jusqu’au souvenir qu’on tente de raviver – mais on est gêné, on n’ose même plus le faire tant la juxtaposition des images du passé et du présent est navrante…
Depuis qu’elle avait quitté la scène en janvier 2008 en une ultime tentative de renaissance avortée dont on regarde aujourd’hui les images avec émotion, depuis qu’un AVC lui avait brisé la voix et l’avait privée en partie de sa mobilité – de son visage, on ne sait pas, la seule image d’elle ayant filtré la montrait somme toute inchangée malgré les cheveux blancs – Catherine Ribeiro n’était déjà plus qu’une ombre. Pour l’immense majorité des moins de soixante ans, elle n’avait tout simplement jamais existé, effacée de la mémoire collective. Aujourd’hui, cette ombre qui subsistait encore, douloureusement, quelque part dans une maison de retraite du sud de la France, n’est plus, et le passé remonte, Ribeiro resurgit sur les écrans de la mémoire avec une violence intacte, sidérante, sitôt lus les mots redoutés en première page du Monde : la chanteuse Catherine Ribeiro est morte. Pour beaucoup, dont je suis, c’est notre jeunesse qui est morte, on le savait, mais le voir ainsi crûment proclamé dans Le Monde…
Catherine Ribeiro, dont j’inscrivais obsessionnellement le nom sur tous mes agendas de lycéen, dont les affiches ornaient encore les murs de ma chambre d’étudiant, est morte – c’est le lycéen resté vivant en moi qui reçoit la nouvelle comme un coup au cœur et se met à pleurer (à hurler, plutôt…), pendant que celui que je suis censé être, en surface, continue machinalement ses affaires.
Elle n’était pas tout à fait ce que dit le journal, cette statue de « passionaria rouge » engagée, irréprochable, exemplaire, ce ne sont là que des simplifications journalistiques, des étiquettes mal ajustées, des clichés. Elle n’était pas non plus libre, seulement déchirée, entravée par son passé, par cette folie destructrice qui, au moins autant que le système économique et la censure politico-médiatique, l’a empêchée d’aller jusqu’au bout de son art. Cela, tous ceux qui l’ont approchée d’un peu près le savent, mais on ne le dit pas trop pour ne pas abîmer l’idéal qu’on a soi-même projeté sur la dite statue. Il me semble pourtant que l’aimer véritablement, c’est l’aimer telle qu’elle était, avec ses failles, ses contradictions, son caractère impossible – l’aimer comme Marie-Thérèse Mutin était capable de le faire, par exemple, elle qui est probablement la seule à avoir dressé de Ribeiro un portrait véridique dans la longue préface au livre Poème en la 440.
Mais revenons un peu en arrière, à ce qui fut pour moi l’origine d’une passion intense et dangereuse – je livre mon témoignage qui est, bien sûr, hommage, et à décharge (car dieu sait si elle fut accusée de tout, et encore aujourd’hui !…).
Catherine Ribeiro, ce fut d’abord pour moi une voix sans visage, presque sans paroles, que j’ai entendue lorsque j’avais une dizaine d’années, une voix vibrante, puissante, ensorcelante, portée par les boucles obsédantes de Patrice Moullet sur le disque Percuphonante que ma mère écoutait en 1986 et que je continue à tenir pour le plus beau. Quelques années plus tard (probablement fin 91 ou début 92), je suis installé dans ma chambre sous les combles, quand Josette remet ce disque. Comme l’isolation de notre vieille maison est mauvaise, j’entends, je retrouve cette voix filtrée, assourdie, qui me ramène aussitôt en arrière et me bouleverse (c’est un fait que tout ce qui me bouleverse est en lien avec des choses vécues dans l’enfance, oubliées puis retrouvées, il en fut de même pour les grottes de Dordogne et pour bien d’autres choses). Comme aimanté, déjà ensorcelé, je descends les deux escaliers, m’approche mine de rien de l’antique tourne-disque, m’empare de la pochette du grand vinyle et lis : Catherine Ribeiro, Percuphonante. Les enceintes diffusent très fort l’emphatique refrain de « Paix 86 ». C’est le début d’une étrange aventure.
Il n’y a pas d’autres disques de la dame à la maison, hormis Le blues de Piaf qu’il me faudra quelques années pour apprécier à sa juste valeur. Alors, comme à mon habitude, j’enquête. Je retrouve une vidéo de 1986 où la chanteuse, magnifique, interprète en tremblant « Le manque » à la télévision, puis dit à Drucker avec une candeur désarmante son trac et son désir désespéré de continuer à chanter. Au disquaire qui s’amuse de ce qu’un jeune homme de mon âge écoute cette chanteuse qui, me dit-il, est « folle », j’achète les rares CD disponibles, 1989 déjà et le double coffret de compilation de la période Alpes. Je me procure un à un, dans toutes les brocantes et les foires aux disques puisqu’Internet n’existait pas, tous ses 33 et 45 tours, de Lumière écarlate (un long cri « dingue » dans la tête jusqu’au divin apaisement de la « Ballada das aguas ») à Soleil dans l’ombre (je peine d’abord à reconnaître sa voix, lissée par les arrangements de Matioszeck, mais le disque reste percutant). Je découpe les articles, revis avec une décennie de décalage les années fastes du groupe Alpes, me laisse happer par la légende.
Ce qui me touche chez Ribeiro, ce n’est pourtant pas tellement la « passionaria rouge », la chanteuse « engagée » qu’évoquent les articles de presse et la plupart des admirateurs plus âgés que je rencontre. Les temps ont changé, et si je peux ressentir une certaine nostalgie pour ces utopies collectives qui n’ont pas survécu aux années 1980, ce n’est pas ce qui m’importe. Les diatribes trop directes de certains textes improvisés ou écrits à la hâte (comme le « Poème non épique n°3 » de l’album Libertés ?) me mettent plutôt mal à l’aise, comme certaines facilités de Ferré chantant la « révolution » sous les acclamations mécaniques du public de Bobino. Ce qui me touche, c’est l’absence de distance entre la femme et la chanteuse, sa capacité à faire coïncider l’art et la vie – le temps d’un monologue déchirant (« Qui a parlé de fin ? »), d’une chanson ou, plus tard, d’un récital ; c’est aussi l’incroyable douceur qui passe dans sa voix, quand la violence laisse place à la tendresse (« Amour petite flamme », « Elles… »), et l’extrême finesse de ses interprétations dans lesquelles l’emphase et la retenue, le déploiement et le repli, alternent avec une justesse stupéfiantes. Ribeiro est peut-être avant tout une immense interprète, capable de s’approprier en les recréant les titres les plus périlleux (« La mémoire et la mer »…).
Chaque matin, je me réveille en l’écoutant. Allongé dans le noir, j’écoute « Cette voix » qui me soulève jusqu’au plafond. Je n’ai jamais pris de drogues, ai-je souvent dit, jamais – mais j’ai écouté Ribeiro / Alpes, alors… Le rêve, bien sûr, ce serait de la voir, la voix (une publicité récupérée je ne sais où et que j’ai affichée à mon chevet a osé ce jeu de mots : « Catherine Ribeiro, la voix, la voir ! », ce qui me rassure car je constate que ma passion chronologiquement décalée n’est pas si solitaire !). Je la sais emportée dans le cauchemar de la drogue par le biais du corps de sa fille Iona. Un enregistrement public à l’Auditorium du Châtelet de reprises en piano-voix, L’amour aux nus, est paru en CD début 1992 – disque dont je trouve une nouvelle mouture à la pochette améliorée chez un disquaire chambérien, ce qui me fait alors fondre en larmes au grand étonnement du disquaire qui la pense toujours aussi populaire et ne sait pas qu’elle n’a même plus la possibilité de chanter sur scène, faute d’engagements. Je guette en vain un concert éventuel.
Ce doit être à cette période que se situe cette interminable conversation téléphonique de Catherine avec ma mère, et moi pendu à l’écouteur mais n’osant pas dire un mot… Josette a quitté le travail pour répondre au rendez-vous fixé, ne pensant pas que l’entretien va durer plus de deux heures… J’écoute, nous écoutons tous deux, gravement la voix grave qui se confie (« Je vis depuis deux ans dans l’enfer de la drogue par le biais du corps de ma fille, je suis désespérée… »), qui fait revivre des pans de son passé, avec toujours cette naïveté adolescente qui déconcerte. Je l’entends encore s’exclamer : « Vous vous rendez compte, Josette, je viens d’avoir cinquante ans mais vous savez que je n’ai pas une ridule ? Pas une ridule, vraiment ! »
Puis la nouvelle tombe, en septembre 92 : Catherine Ribeiro s’est tiré deux balles dans la gorge, sa voix est perdue et certains journaux la donnent pour morte. Je ne la verrai jamais. J’achète la presse de caniveau qui montre son visage blême, juste avant le drame. J’en fais des cauchemars, et de très mauvais poèmes.
Elle qui se dira plus tard « surdouée de la survivance », pourtant survit. Le pistolet d’alarme qui l’a tant fait souffrir en criblant sa gorge de plombs a miraculeusement épargné ses cordes vocales et, l’un dans l’autre, joué son rôle, puisque la voici invitée de nouveau à la radio, à la télévision, aux Francofolies – j’ai quelque part toutes les bandes enregistrées alors où on la voit chantant en vacillant, bouleversante, Bref, Piaf ou Aragon. On annonce un concert à Arcueil en banlieue parisienne le 16 octobre 1992, et c’est ainsi que je la vois pour la première fois, dans une petite salle un peu sinistre mais pleine de camarades venus la soutenir.
L’atmosphère est tendue, électrique. Pourra-t-elle chanter ? Macabre suspense, on murmure que les médecins lui ont dit que c’était de la folie, ce qui lui va très bien puisque, c’est vrai, je le confirme, elle est folle, Ribeiro, complètement dingue… Après la longue, très longue introduction du piano, la voici dans le faisceau du projecteur, chancelante, amaigrie, qui s’accroche au micro et lâche dans un souffle : « ça me fait tout drôle… d’être là ».
J’écoute aujourd’hui sur une vieille cassette au son épouvantable les acclamations étranglées du jeune homme au chapeau noir que j’étais… J’entends encore l’écho des voix des spectateurs criant, en fin de récital, tous les titres de la période d’Alpes qu’elle ne saurait chanter ainsi, en piano-voix, mais qui reprennent vie d’être seulement nommés… Je retrouve cette photo prise d’elle, superbe, en veste de cuir noir, dédicaçant avec un professionnalisme irréprochable les affiches qu’on lui tend, souriant et plaisantant même avec tout un chacun, comme si de rien n’était, comme si tout allait bien… Il parait que Judy Garland renaissait à chaque fois qu’elle remontait sur scène : cela, je ne l’ai pas vu, mais j’ai vu renaître Ribeiro sur la scène d’Arcueil…
Pendant les années qui ont suivi, je l’ai vue, je l’ai suivie, j’ai la mémoire qui flanche, à Villeneuve d’Ascq un 9 mars (magnifique version du sinistre « Jour de fête »…), à Lignières, à Saint-Etienne, aux Francofolies de La Rochelle, aux Bouffes du Nord pour son fulgurant « come back », à Dijon le jour de la parution de mon premier livre… Je l’ai vue parfois charmante et drôle, ou bien terriblement inquiétante lorsqu’on la sentait sur le point de basculer et que l’on redoutait ce qu’elle était capable de dire ou de faire, dans l’affolement et la déprime… Un soir, prostrée dans sa loge, elle refuse de monter sur scène – le concert aura lieu après plus d’une heure d’attente angoissée… Un autre soir de grande déprime, dans un restau d’après concert où le champagne ne console plus de rien, elle me dit, terrible, ses longues mains tremblant plus que jamais au-dessus de la table : « J’ai mis la barre très haut et je suis restée en bas, je suis désespérée ». C’est sincère et c’est vrai, le décalage entre le personnage qu’elle s’était construit et la réalité de sa personne était invivable, comme pour beaucoup d’artistes, et je constate peu à peu que cette coïncidence entre la femme et la chanteuse qui m’avait tant impressionné, au fond, est un leurre.
Je l’ai vue renaître et se perdre dans un « vivre libre » pas si libre… et que, pourtant, j’ai aimé et j’aime encore. Elle écrit dans « Cette voix… » que son chant « fit des heureux, des malheureux » : avec le temps je me suis rendu compte que c’était un chant qui m’était dangereux, chant de sirène plutôt que chant d’Orphée, et je me suis éloigné, ne la suivant plus qu’à distance. Elle reste pourtant si bien ancrée en moi qu’il n’y a pas une semaine où je ne fredonne l’air de « Paix », où je ne rêve d’elle. La revoyant chanter « Tous les droits », « Dingue » ou « Un jour la mort » je reste sidéré. En ce jour du 23 août où Nathalie fête ses cinquante ans, je n’arrive pas à m’arracher de l’écran où roulent les commentaires qui disent, sur tous les tons : Catherine, notre jeunesse est morte.
23/08/24